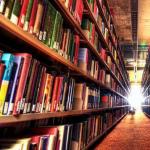Analyse Shalamov des histoires. Mikhaïl Mikheev. Comment l'histoire « Dans la neige » a été réalisée. Histoires de Shalamov Kolyma dans l'analyse de la neige
Établissement d'enseignement professionnel budgétaire régional de l'État "Collège de technologies et de services industriels de Zelenogorsk"
Littérature
Technologie pédagogique « Méthode d'enseignement dialectique »
Questions de jugement pour l'histoire de V.T. Shalamov « Lait concentré » (2e année, 11e année)
préparé
professeur de langue et littérature russes
Azarova Svetlana Vassilievna
Zelenogorsk
1. Comment expliquer que les prisonniers étaient jaloux de Chestakov ?
2.Comment prouver que le héros a constamment faim ?
3.Quand le héros de l'histoire a-t-il rencontré Chestakov ?
4. Dans quel cas un prisonnier pourrait-il obtenir un emploi dans sa spécialité dans le camp ?
5. Comment Chestakov trouve-t-il sa place « chaleureuse » ?
6. Pourquoi le héros a-t-il refusé l’offre de Chestakov de s’échapper ?
7. Pourquoi le héros a-t-il d'abord mangé du lait concentré puis a-t-il refusé de s'échapper ?
Réponses:
1. « À la mine, Chestakov n'a pas travaillé au visage. Il était ingénieur géologue et il a été embauché pour travailler dans l’exploration géologique, au bureau. Les prisonniers enviaient ceux qui « réussissaient à trouver un emploi dans un bureau, un hôpital, une étable – il n’y avait pas d’heures de dur labeur physique là-bas ». La journée de travail durait seize heures, ce que peu de détenus pouvaient supporter.
2. Le héros a constamment faim. Debout devant l’épicerie, incapable d’acheter, il ne peut « quitter des yeux les miches de pain couleur chocolat ». Il se lève, regarde le pain et n'a pas la force d'aller à la caserne. "Changer de bonheur", le héros "ordonne" du lait en conserve à Chestakov, et la nuit, il voit dans un rêve une énorme boîte de lait concentré. « L'immense pot, bleu comme le ciel nocturne, était percé en mille endroits, et le lait s'infiltrait et coulait dans un large ruisseau de la Voie Lactée. Et j’ai facilement atteint le ciel avec mes mains et j’ai mangé le lait épais, sucré et étoilé. En attendant, le héros ne se souvenait pas de ce qu'il avait fait ni de la façon dont il travaillait ce jour-là. Ayant reçu le lait concentré promis, il mangea deux boîtes à la fois.
3. Le héros a rencontré Chestakov sur le « Grand Pays », dans la prison de Butyrka, il était assis dans la même cellule que lui.
4. Le plus souvent, un détenu recevait un travail dans sa spécialité, « dans un bureau », s'il acceptait de répondre à toutes les exigences de ses supérieurs : collecter et rapporter les informations nécessaires, organiser des provocations entre détenus, etc. «... Et soudain, j'ai eu peur de Chestakov, le seul d'entre nous à avoir obtenu un emploi dans sa spécialité. Qui l'a amené là et à quel prix ? Il faut tout payer. Le sang de quelqu’un d’autre, la vie de quelqu’un d’autre. »
5. Chestakov a persuadé cinq prisonniers de s'évader. "...Deux ont été tués non loin des Black Keys, trois ont été jugés un mois plus tard." Chestakov a été transféré dans une autre mine. "Il n'a pas reçu de peine supplémentaire pour évasion ; ses supérieurs ont joué honnêtement avec lui."
Mikhaïl Yurievitch Mikheev m'a permis de bloguer un chapitre de son prochain livre "Andrei Platonov... et autres. Langues de la littérature russe du XXe siècle.". Je lui suis très reconnaissant.À propos du titre Parabole de Shalamov, ou une éventuelle épigraphe des « Contes de Kolyma »
I À propos de la miniature « Dans la neige »
Franciszek Apanovich, à mon avis, a appelé très justement le croquis miniature « Dans la neige » (1956), qui ouvre les « Contes de la Kolyma », « une introduction symbolique à la prose de la Kolyma en général », estimant qu'il joue le rôle d'une sorte de métatexte par rapport au tout entier1 . Je suis entièrement d'accord avec cette interprétation. Il convient de noter la fin mystérieuse de ce tout premier texte de Shalamovsky cinq-livres. « À travers la neige » doit être reconnu comme une sorte d'épigraphe de tous les cycles des « Contes de la Kolyma »2. La toute dernière phrase de ce premier sketch ressemble à ceci :
Et ce ne sont pas les écrivains qui conduisent des tracteurs et des chevaux, mais les lecteurs. ## (« Dans la neige »)3
Comment ça? Dans quel sens? - après tout, si sous écrivain Shalamov se comprend, mais lecteurs se rapporte à vous et moi, alors comment Nous impliqué dans le texte lui-même ? Pense-t-il vraiment que nous irons aussi à la Kolyma, que ce soit en tracteur ou à cheval ? Ou bien le terme « lecteurs » désigne-t-il les serviteurs, les gardes, les exilés, les civils, les autorités du camp, etc. ? Il semble que cette phrase finale soit fortement dissonante avec l'esquisse lyrique dans son ensemble et avec les phrases qui la précèdent, qui expliquent la « technologie » spécifique consistant à piétiner la route à travers la neige vierge difficile à franchir de la Kolyma (mais pas du tout la relation entre lecteurs et écrivains). Voici les phrases qui le précèdent, depuis le début :
# Le premier traverse la période la plus difficile de toutes, et lorsqu'il est épuisé, un autre du même top cinq se présente. Parmi ceux qui suivent le sentier, tous, même les plus petits, les plus faibles, doivent marcher sur un morceau de neige vierge, et non sur le sentier d’autrui4.
Ceux. ceux qui roulent et ne marchent pas ont une vie « facile », tandis que ceux qui piétinent et piétinent la route doivent faire le plus de travail. Initialement, à ce stade du texte manuscrit, la première phrase du paragraphe donnait au lecteur une indication plus claire sur la façon de comprendre la fin qui la suivait, puisque le paragraphe commençait par un barré :
# Ainsi va la littérature. L’un, puis l’autre, s’avance et ouvre la voie, et parmi ceux qui suivent le sentier, même tous, même les plus faibles, les plus petits, doivent marcher sur un morceau de neige vierge, et non sur le sentier d’autrui.
Cependant, à la toute fin - sans aucune modification, comme si elle avait déjà été préparée à l'avance - il y avait une dernière phrase dans laquelle le sens de l'allégorie et, pour ainsi dire, l'essence de l'ensemble, le mystérieux symbole de Shalamov était concentré:
Et ce ne sont pas les écrivains qui conduisent des tracteurs et des chevaux, mais les lecteurs.5 ##
Cependant, en réalité, à propos de ceux qui monte des tracteurs et des chevaux, avant cela dans le texte "Dans la neige", et dans les histoires suivantes - ni dans le deuxième, ni dans le troisième, ni dans le quatrième ("Au spectacle" 1956; "La nuit"6 1954, "Carpenters" 1954 ) - en fait, ce n'est pas dit7. Un vide sémantique apparaît, que le lecteur ne sait pas comment combler, et l'écrivain, apparemment, l'a recherché ? Ainsi, la première parabole de Shalamov est révélée - non pas directement, mais indirectement exprimée, implicite.
Je remercie Franciszek Apanowicz pour son aide dans son interprétation. Il a déjà écrit sur toute l’histoire dans son ensemble :
On a l'impression qu'il n'y a pas ici de narrateur, il y a seulement ce monde étrange qui se développe tout seul à partir des maigres mots de l'histoire. Mais même ce style de perception mimétique est réfuté par la dernière phrase de l'essai, totalement incompréhensible de ce point de vue.<…>Si nous le prenons au pied de la lettre, nous devrions arriver à la conclusion absurde que dans les camps de la Kolyma, seuls les écrivains foulent les routes. L’absurdité d’une telle conclusion nous oblige à réinterpréter cette phrase et à la comprendre comme une sorte d’énoncé métatextuel, appartenant non pas au narrateur, mais à un autre sujet, et perçu comme la voix de l’auteur lui-même8.
Il me semble que le texte de Chalamov est ici délibérément erroné. Le lecteur perd le fil de l’histoire et le contact avec le narrateur, ne comprenant pas où se trouvent chacun d’entre eux. Le sens de la mystérieuse phrase finale peut aussi être interprété comme une sorte de reproche : les prisonniers avancent, en neige purement blanche, - intentionnellement sans y aller suivez-vous les uns les autres, ne vous piétinez pas général le chemin et généralement agir pas de cette façon, Comment lecteur qui est habitué à utiliser des moyens tout faits, des normes établies par quelqu'un avant lui (guidé, par exemple, par quels livres sont à la mode ou quelles « techniques » sont utilisées chez les écrivains), mais agit exactement comme de vrais écrivains: ils essaient de placer leurs pieds séparément en marchant ton propre chemin, ouvrant la voie à ceux qui les suivent. Et seulement rares d'entre eux - c'est-à-dire ces mêmes cinq pionniers choisis ont la possibilité, pendant une courte période, jusqu'à épuisement, de parcourir ce chemin nécessaire - pour ceux qui suivent, sur des traîneaux et sur des tracteurs. Les écrivains, du point de vue de Chalamov, doivent - ils sont directement obligés, si, bien sûr, ils sont de vrais écrivains, de se déplacer sur le sol vierge (« à leur manière », comme le chantera plus tard Vysotsky). Autrement dit, contrairement à nous, simples mortels, ils ne conduisent pas de tracteurs ni de chevaux. Shalamov invite également le lecteur à prendre la place de ceux qui ouvrent la voie. La phrase mystérieuse se transforme en un riche symbole de toute l'épopée de la Kolyma. Après tout, comme nous le savons, le détail de Chalamov est un détail artistique puissant qui est devenu un symbole, une image (« Carnets », entre avril et mai 1960).
Dmitry Nich a noté : à son avis, ce même texte en tant qu'« épigraphe » fait également écho au premier texte du cycle « Résurrection du mélèze » - une esquisse bien plus tardive « Le Chemin » (1967)9. Rappelons-nous ce qui s'y passe et ce qui se passe en quelque sorte dans les coulisses de ce qui se passe : le narrateur trouve « son » chemin (ici le récit est personnifié, contrairement à « Dans la neige », où il est impersonnel10) - le chemin sur lequel il marche seul, depuis près de trois ans, et dans lequel naissent ses poèmes. Cependant, dès qu’il s’avère que ce chemin qu’il aimait, parcouru, parcouru comme s’il lui appartenait, a également été ouvert par quelqu’un d’autre (il y remarque l’empreinte d’un autre), il perd ses propriétés miraculeuses :
J'ai eu un magnifique sentier dans la taïga. Je l'ai posé moi-même en été, alors que je stockais du bois de chauffage pour l'hiver. (...) Le chemin devenait chaque jour plus sombre et finissait par devenir un sentier de montagne gris foncé ordinaire. Personne n'a marché dessus sauf moi. (…) # J'ai suivi ce propre chemin pendant presque trois ans. Des poèmes y étaient bien écrits. Autrefois, vous reveniez d'un voyage, vous vous prépariez à partir sur un sentier et vous trouviez inévitablement une strophe sur ce sentier. (...) Et le troisième été, un homme a marché sur mon chemin. Je n'étais pas chez moi à ce moment-là, je ne sais pas si c'était un géologue errant, ou un facteur de montagne à pied, ou un chasseur - l'homme a laissé des traces de lourdes bottes. Depuis, aucune poésie n’a été écrite sur ce chemin.
Ainsi, contrairement à l'épigraphe du premier cycle (« Dans la neige »), ici, dans « Le Chemin », l'accent change : premièrement, l'action elle-même n'est pas collective, mais est soulignée individuellement, voire individualiste. C'est-à-dire que l'effet du piétinement de la route elle-même par d'autres, camarades, dans le premier cas seulement intensifié, est devenu plus fort, mais ici, dans le second, dans un texte écrit plus d'une douzaine d'années plus tard, il disparaît du fait que quelqu'un a marché sur le chemin, un autre. Alors que dans "À travers la neige", le motif même de "marcher uniquement sur un sol vierge, et non sentier après sentier" se chevauchait par l'effet du "bénéfice collectif" - tous les tourments des pionniers n'étaient nécessaires que pour que plus loin, les suivant , ils allaient sur les lecteurs de chevaux et de tracteurs. (L'auteur n'est pas entré dans les détails, eh bien, ce trajet est-il vraiment nécessaire ?) Maintenant, il semble qu'aucun bénéfice pour le lecteur et altruiste ne soit plus visible ou envisagé. Un certain changement psychologique peut être détecté ici. Ou encore l’éloignement délibéré de l’auteur du lecteur.
II Confession - dans un essai scolaire
Curieusement, les propres opinions de Shalamov sur ce que devrait être la « nouvelle prose » et sur ce à quoi, en fait, un écrivain moderne devrait s'efforcer, sont présentées le plus clairement non pas dans ses lettres, ni dans des cahiers ni dans des traités, mais dans des essais, ou simplement un « essai scolaire » écrit en 1956 - derrière Irina Emelyanova, fille d'Olga Ivinskaya (Shalamov connaissait cette dernière depuis les années 30), lorsque cette même Irina entra à l'Institut littéraire. En conséquence, le texte lui-même, que Shalamov a délibérément compilé d'une manière quelque peu scolaire, a d'abord reçu de l'examinateur, N.B. Tomashevsky, le fils du célèbre Pouchkiniste, « revue superpositive » (ibid., pp. 130-1)11, et deuxièmement, par une heureuse coïncidence, beaucoup de choses peuvent maintenant être clarifiées pour nous à partir des vues sur la littérature de Chalamov lui-même, qui était déjà pleinement mûr à l'âge de 50 ans pour sa prose, mais à cette époque, semble-t-il, il n'avait pas encore trop « obscurci » ses principes esthétiques, ce qu'il fit clairement plus tard. Voici comment, en utilisant l’exemple des nouvelles d’Hemingway « Quelque chose est fini » (1925), il illustre la méthode qui l’a captivé consistant à réduire les détails et à élever la prose aux symboles :
Les héros de son [histoire] ont des noms, mais n'ont plus de nom de famille. Ils n'ont plus de biographie.<…>Un épisode a été arraché au fond sombre général de « notre époque ». C'est presque juste une image. Le paysage au début n'est pas nécessaire comme fond spécifique, mais comme accompagnement exclusivement émotionnel... Dans cette histoire, Hemingway utilise sa méthode préférée : l'image.<…># Prenons une histoire d'une autre période d'Hemingway - « Là où c'est propre, c'est léger »12. # Les héros n'ont même plus de noms.<…>Ce n'est même plus un épisode. Il n'y a aucune action du tout<…>. Ceci est un cadre.<…># [Ceci] est l'une des histoires les plus frappantes et les plus remarquables d'Hemingway. Tout y est réduit à un symbole.<…># Le chemin depuis les premières histoires jusqu'à « Clean, Light » est un chemin de libération des détails quotidiens, quelque peu naturalistes.<…>Ce sont les principes du sous-texte et du laconisme. "<…>La majesté du mouvement de l’iceberg réside dans le fait qu’il ne s’élève qu’à un huitième de la surface de l’eau. »13 Hemingway minimise les dispositifs linguistiques, les tropes, les métaphores, les comparaisons, le paysage en fonction du style. # ...le dialogue de toute histoire d'Hemingway est la huitième partie de l'iceberg visible à la surface. # Bien sûr, ce silence sur le plus important exige du lecteur qu’il ait une culture particulière, une lecture attentive et une consonance interne avec les sentiments des héros d’Hemingway.<…># Le paysage d'Hemingway est également relativement neutre. Hemingway donne généralement le paysage au début de l'histoire. Le principe de la construction dramatique - comme dans une pièce de théâtre - avant le début de l'action, l'auteur indique le fond et le décor dans les mises en scène. Si le paysage se répète au cours du récit, il est, pour l’essentiel, le même qu’au début. #<…># Prenons le paysage de Tchekhov. Par exemple, du « Quartier n° 6 ». L'histoire commence aussi par un paysage. Mais ce paysage est déjà chargé d’émotions. C'est plus tendancieux que celui d'Hemingway.<…># Hemingway a ses propres dispositifs stylistiques, inventés par lui-même. Par exemple, dans le recueil d'histoires « À notre époque », ce sont des sortes de réminiscences qui précèdent l'histoire. Ce sont les célèbres phrases clés dans lesquelles se concentre le pathétique émotionnel de l'histoire.<…># Il est difficile de dire immédiatement quelle est la tâche des réminiscences. Cela dépend à la fois de l’histoire et du contenu des réminiscences elles-mêmes14.
Ainsi, le laconisme, les omissions, la réduction de l'espace réservé aux paysages et - ne montrant, pour ainsi dire, que des « cadres » individuels - au lieu de descriptions détaillées, et même l'élimination obligatoire des comparaisons et des métaphores, ce douloureux « truc littéraire », l'expulsion de le texte tendancieux, le rôle du sous-texte, les phrases clés, les réminiscences - ici littéralement tous les principes de la propre prose de Shalamov sont répertoriés ! Il semble que ni plus tard (dans le traité exposé dans une lettre à I.P. Sirotinskaya « Sur la prose », ni dans des lettres à Yu.A. Schrader), ni dans des journaux et des cahiers, il n'ait exposé ses théories. nouveau prose.
C'est peut-être ce à quoi Shalamov n'a jamais réussi d'aucune façon - mais ce pour quoi il s'est constamment efforcé de restreindre l'expression trop directe et immédiate de ses pensées et de ses sentiments, en concluant l'essentiel de l'histoire en sous-texte et en évitant les déclarations et évaluations directes catégoriques. . Ses idéaux semblaient complètement platoniciens (ou, peut-être, dans son esprit, hemingwayiens). Comparons cette appréciation du plus « Hemingway », comme on le considère habituellement pour Platonov, « Le Troisième Fils » :
Le troisième fils a expié le péché de ses frères, qui ont organisé une bagarre à côté du cadavre de leur mère. Mais Platonov n'a même pas l'ombre d'une condamnation à leur égard, il s'abstient généralement de toute évaluation, dans son arsenal il n'y a que des faits et des images. C'est en quelque sorte l'idéal d'Hemingway, qui s'est efforcé avec persistance d'effacer toute appréciation de ses œuvres : il n'a presque jamais rapporté les pensées des personnages - seulement leurs actions, soigneusement barré dans ses manuscrits toutes les phrases commençant par le mot « Comment », sa célèbre déclaration sur un huitième de l’iceberg concernait en grande partie des évaluations et des émotions. Dans la prose calme et sans hâte de Platonov, non seulement l’iceberg des émotions ne dépasse nulle part, mais il faut plonger à une profondeur considérable pour l’obtenir15.
Ici, nous pouvons seulement ajouter que le propre « iceberg » de Shalamov est toujours dans un état « sur le point de chavirer » : à chaque « cycle » (et à plusieurs reprises), il nous montre encore sa partie sous-marine... Politique, et simplement mondaine, Le tempérament de « fan » de cet écrivain était toujours hors du commun ; il ne pouvait pas maintenir le récit dans les limites de l'impartialité.
1 Apanovich F. Sur les fonctions sémantiques des connexions intertextuelles dans « Kolyma Stories » de Varlam Shalamov // IV Lectures internationales de Shalamov. Moscou, 18-19 juin 1997 :
Résumés de rapports et de messages. - M. : Republic, 1997, pp. 40-52 (en référence à Apanowicz F. Nowa proza Warlama Szalamowa. Problemy wypowiedzi artystycznej. Gdansk, 1996. S. 101-103) http://www.booksite.ru /varlam /reading_IV_09.htm
2 L'auteur a travaillé sur eux (dont « La Résurrection du mélèze » et « Le Gant ») pendant vingt ans - de 1954 à 1973. On peut les considérer comme cinq ou même six livres, selon que les « Essais sur les enfers », qui se démarquent quelque peu, sont inclus dans le CD.
3 Le signe # indique le début (ou la fin) d'un nouveau paragraphe dans une citation ; signe ## - fin (ou début) de tout le texte - M.M.
4 La modalité est donnée ici comme un refrain obligations. Il s'adresse par l'auteur à lui-même, mais aussi au lecteur. Ensuite, cela se répétera dans de nombreuses autres histoires, comme par exemple dans le final de la suivante (« Au spectacle ») : Il fallait maintenant chercher un autre partenaire pour scier le bois.
5 Manuscrit «Sur la neige» (code en RGALI 2596-2-2 - sur le site http://shalamov.ru/manuscripts/text/2/1.html). Le texte principal, l'édition et le titre du manuscrit sont au crayon. Et au-dessus du titre, apparemment, se trouve le titre initialement prévu pour l'ensemble du cycle - Dessins du Nord ?
6 Comme le montre le manuscrit (http://shalamov.ru/manuscripts/text/5/1.html), le titre original de cette nouvelle, puis barré, était « Lingerie » - ici le mot est dans guillemets ou y a-t-il des signes des deux côtés du nouveau paragraphe "Z" ? - C'est à dire [«Lingerie» la Nuit] ou : [zLingeriez la Nuit]. Voici le titre du récit « Kant » (1956) - dans le manuscrit entre guillemets, ils sont laissés dans l'édition américaine de R. Gul (New Journal n°85 1966) et dans l'édition française de M. Geller ( 1982), mais pour une raison quelconque, ils ne figurent pas dans l'édition de Sirotinskaya. - Autrement dit, ce n'est pas clair : les guillemets ont été supprimés par l'auteur lui-même, dans certaines éditions ultérieures - ou s'agit-il d'un oubli (arbitraire ?) de l'éditeur. Selon le manuscrit, les guillemets se trouvent également à de nombreux autres endroits où le lecteur rencontre des termes spécifiquement campés (par exemple, dans le titre de l'histoire « Au spectacle »).
7 Le tracteur ne sera évoqué à nouveau pour la première fois qu'à la fin de « Single Measurement » (1955), soit trois histoires depuis le début. Le premier indice sur l'équitation dans le même cycle se trouve dans l'histoire « Le charmeur de serpents », c'est-à-dire déjà à 16 étages de là. Eh bien, à propos des chevaux dans des charrettes en traîneau - dans "Shock Therapy" (1956), après 27 histoires, plus près de la fin du cycle entier.
8 Franciszek Apanowicz, « Nowa proza » Warłama Szałamowa. Problème wypowiedzi artystycznej, Gdańsk, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 1986, art. 101-193 (traduction de l'auteur lui-même). Ainsi, dans sa correspondance personnelle, Franciszek Apanovich ajoute : « Shalamov était convaincu qu'il ouvrait une nouvelle voie à la littérature, sur laquelle aucun homme n'avait encore mis les pieds. Non seulement il se considérait comme un pionnier, mais il pensait également qu'il y avait peu d'écrivains de ce type qui ouvrent de nouvelles voies.<…>Eh bien, dans un sens symbolique, le chemin ici est parcouru par des écrivains (je dirais même des artistes en général), et non par des lecteurs, sur lesquels on n'apprend rien sinon qu'ils montent des tracteurs et des chevaux.
9 Il s'agit d'une sorte de poème en prose, note Nitsch : « le chemin ne sert de chemin vers la poésie que jusqu'à ce qu'une autre personne l'emprunte. Autrement dit, un poète ou un écrivain ne peut pas suivre les traces des autres » (dans une correspondance électronique).
10 Comme un clochard Utah route à travers la neige vierge ? (…) Les routes sont toujours tracées Utah les jours calmes, pour que les vents n'emportent pas les travaux humains. L'homme lui-même planifie Non soi-même des repères dans l'immensité de la neige : un rocher, un grand arbre... (c'est moi qui souligne - M.M.).
11 Irina Emelyanova. Pages inconnues de Varlam Shalamov ou l'Histoire d'une « arrivée » // Grani n° 241-242, janvier-juin 2012. Pages Tarusa. Volume 1, Moscou-Paris-Munich-San Francisco, p.131-2) - également sur le site http://shalamov.ru/memory/178/
12 [L'histoire a été publiée en 1926.]
13 [Shalamov cite Hemingway lui-même, sans référence précise à
Sections: Littérature
Objectifs de la leçon:
- présenter le destin tragique de l'écrivain et poète Varlam Shalamov ; identifier les caractéristiques de l'intrigue et de la poétique des « Contes de Kolyma » ;
- développer des compétences d'analyse littéraire et la capacité de dialoguer ;
- former la position civique des lycéens.
Équipement: portrait de V. Shalamov, présentation multimédia
Pendant les cours
1. Étape de définition des objectifs.
Musique. "Requiem" de W. Mozart
Professeur(lit sur fond de musique)
À tous ceux qui ont été marqués en vertu de l'article cinquante-huit,
qui même en rêve était entouré de chiens, d'une escorte féroce,
qui devant le tribunal, sans procès, par assemblée extraordinaire
était voué à un uniforme de prison jusqu'à la tombe,
qui était fiancé par le destin à des chaînes, des épines, des chaînes
Ce sont nos larmes et notre chagrin, notre mémoire éternelle ! (T. Ruslov)
Aujourd'hui, en classe, nous allons parler des répressions politiques en Union soviétique, des personnes qui en ont souffert, de l'écrivain au destin étonnant - Varlam Tikhonovitch Shalamov - et de sa prose. Ouvrez vos cahiers et notez le sujet de la leçon d'aujourd'hui.
(diapositive 1). À la maison, vous lisez les histoires de Varlam Shalamov. Quel est notre objectif pour la leçon d'aujourd'hui ? (Réponses des étudiants : se familiariser avec l'œuvre de V. Shalamov, sa biographie, comprendre ses œuvres).
Varlam Tikhonovitch Shalamov a passé près de 20 ans dans les camps soviétiques, a survécu, a persévéré et a trouvé la force d'écrire à ce sujet dans son ouvrage « Contes de Kolyma », dont vous avez déjà rencontré certains. Comment avez-vous reçu ces histoires ? Qu'est-ce qui a surpris, étonné, indigné ? (Réponses des élèves)
Quel est le mystère des « Contes de Kolyma » ? Pourquoi l'auteur lui-même considère-t-il ses œuvres comme une « nouvelle prose » ? Ce sont les questions clés de notre leçon (diapositive 2).
2. Actualisation des connaissances des étudiants.
Mais pour comprendre la prose de Chalamov, il faut bien comprendre les événements historiques de ces années-là.
Message étudiant "Histoire des répressions en URSS"
A.I. Soljenitsyne a déclaré : « Aucun Gengis Khan n'a détruit autant de paysans que nos glorieux organes dirigés par le Parti. » Bien entendu, tout cela ne pouvait pas affecter le processus littéraire. Rappelons quelques faits.
Message de l'étudiant "La répression en littérature"(Il convient de mentionner les faits suivants : Alexandre Blok a étouffé à cause du manque d'air de liberté en 1921. Abattu : Nikolaï Gumilyov en 1921 pour complot contre-révolutionnaire, Boris Pilniak en avril 1938, Nikolaï Klyuev et Sergueï Klychkov en octobre 1937, Isaac Babel en janvier 1940. Ossip Mandelstam est mort dans un camp en 1938. Se sont suicidés, incapables de résister au duel avec le régime totalitaire, Sergueï Yesenin en 1925, Vladimir Maïakovski en 1930, Marina Tsvetaeva en 1941. Ivan Bounine, Zinaida Gippius sont morts en exil , Dmitri Merezhkovsky, Igor Severyanin, Vyacheslav Ivanov, Konstantin Balmont, Joseph Brodsky, Alexander Galich. Anna Akhmatova, Mikhail Zoshchenko, Boris Pasternak ont été persécutés. Passés par le Goulag Alexandre Soljenitsyne, Anatoly Zhigulin, Nikolai Zabolotsky, Yaroslav Smelyakov, Joseph Brodsky. Dans la Maison des écrivains de Moscou, il y a une plaque commémorative à la mémoire des écrivains morts pendant la guerre - 70. Ils ont proposé d'accrocher la même plaque avec les noms des personnes réprimées, mais ils ont ensuite réalisé qu'il n'y avait pas assez de place. Tous les murs seront couverts d'écritures.)
Professeur. Citons un autre nom dans cette triste liste - V.T. Shalamov, l'un de ceux qui se sont donné pour tâche de survivre et de dire la vérité. Ce thème est entendu dans les œuvres de A. Soljenitsyne, Yuri Dombrovsky, Oleg Volkov, Anatoly Zhigulin et Lydia Chukovskaya, mais la puissance des livres de V. Shalamov est tout simplement incroyable (diapositive 3).
Dans le sort de Shalamov, deux principes se sont heurtés : d'une part, son caractère et ses convictions, de l'autre, la pression du temps, l'État, qui cherchait à détruire cet homme. Son talent, sa soif passionnée de justice. Intrépidité, volonté de prouver sa parole par des actes : tout cela non seulement n'était pas demandé par le temps, mais devenait également trop dangereux pour lui.
3. Étudier du nouveau matériel. Travaillez en groupes pour étudier la biographie de Varlam Shalamov.
Travaillez en groupe. (Les étudiants sont divisés en groupes à l'avance.)
Sur chaque table se trouvent des textes avec la biographie de V.T. Shalamov. Lisez, soulignez les principales étapes de la biographie (avec un marqueur), soyez prêt à répondre aux questions.
Des questions:
- Où et quand Chalamov est-il né ? Que pouvez-vous dire de sa famille ?
- Où V. Shalamov a-t-il étudié ?
- Quand V. Shalamov a-t-il été arrêté et pour quoi ?
- Quel a été le verdict ?
- Quand et où Chalamov a-t-il purgé sa peine ?
- Quand Shalamov a-t-il été de nouveau arrêté ? Quelle est la raison?
- Pourquoi sa peine a-t-elle été prolongée en 1943 ?
- Quand Shalamov est-il libéré du camp ? Quand retourne-t-il à Moscou ?
- En quelle année a-t-il commencé à travailler sur « Kolyma Tales » ?
(Les réponses aux questions sont accompagnées de diapositives avec des photographies)
Professeur: Varlam Shalamov est décédé le 17 janvier 1982, ayant perdu l'ouïe et la vue, complètement sans défense dans la Maison du Fonds littéraire pour les invalides, après avoir complètement bu la coupe de la non-reconnaissance de son vivant.
- "Kolyma Tales" est l'œuvre principale de l'écrivain. Il a passé 20 ans à les créer. Le lecteur a appris 137 histoires rassemblées dans 5 recueils :
- "Contes de la Kolyma"
- "Côte Gauche"
- "L'artiste de la pelle"
- "Résurrection du mélèze"
- "Le Gant, ou KR-2"
4. Analyse des "Contes de Kolyma".
- Quelles histoires avez-vous lu ? (Réponses des élèves)
Travailler en équipe de deux.
Faisons un cluster avec le mot "Kolyma". Essayez d'y refléter votre perception du monde de la Kolyma, quels sentiments y prédominent ? Nous travaillons en binôme et essayons de trouver un accord. Nous attachons les clusters au tableau et les lisons.
Passons à l'histoire "Funeral Word". Questions d'analyse :
1. Quelle impression fait une histoire qui commence par les mots : « Tout le monde est mort » ? Tout le monde : qui est-ce, pourquoi, comment ? (réponses) Oui, ce sont des gens dont Chalamov lui-même dira : « C'est le sort des martyrs qui n'étaient pas, n'ont pas pu et ne sont pas devenus des héros. Mais ils sont restés humains dans de telles conditions – et cela signifie beaucoup. L'écrivain le montre en quelques mots, avec un seul détail. Le détail est très important dans la prose de Shalamov. Voici par exemple un petit détail : « : Le brigadier Barbe est un camarade qui m'a aidé à sortir une grosse pierre d'une fosse étroite. » Le brigadier, qui est habituellement un ennemi dans le camp, un meurtrier, s'appelle un camarade. Il a aidé le prisonnier et ne l'a pas tué. Que se révèle-t-il derrière cela ? (En termes de camaraderie, le plan n'a pas été réalisé, car il ne pouvait être exécuté que sous une charge inhumaine et mortelle. Barbe a été signalé et il est mort.)
2. Des histoires effrayantes, des histoires effrayantes. De quoi rêvent les gens la nuit de Noël ? (réponses) Et voici la voix de Volodia Dobrovoltsev (notez le nom de famille) : "Et moi", et sa voix était calme et sans hâte, "je voudrais être un moignon. Un moignon humain, vous savez, sans bras, sans jambes. Ensuite, je trouverais que j'ai la force de leur cracher au visage pour tout ce qu'ils nous font. Pourquoi veut-il être une souche ?
3. Quelle est l’intrigue de l’histoire ? (La mort). La mort, la non-existence est le monde artistique dans lequel se déroule l'histoire. Et pas seulement ici. Le fait de la mort précède le début de l'intrigue. Convenez que c'est inhabituel pour la prose russe.
Travaillons avec l'histoire "Le Charmeur de Serpent". Chaque groupe reçoit sa propre tâche. Groupe 1 - Lisez le début de l'histoire, trouvez des mots et des phrases qui affectent les sentiments du lecteur. Quels sentiments surgissent ? Groupe 2 - Quelles questions « fines » et « épaisses » vous êtes-vous posées en lisant l'histoire ? Groupe 3 - Quels fragments de l'histoire nécessitent compréhension et réflexion ?
Dans le processus d’analyse de l’histoire, nous prêterons certainement attention aux questions difficiles que vous vous posez. Essayons de le comprendre ensemble.
- Pourquoi l'histoire s'appelle-t-elle « Le charmeur de serpent » ? Qui peut être considéré comme un charmeur de serpents ?
- Pourquoi Platonov a-t-il finalement accepté de raconter des romans ? Pouvez-vous lui en vouloir ?
- L’accord de Platonov de « presser les romans » est-il un signe de force ou de faiblesse ?
- Pourquoi Platonov a-t-il développé une maladie cardiaque ?
- Quelle est l’attitude de l’auteur face à cette manière d’améliorer sa situation ? (Fortement négatif)
- Comment Senechka est-elle représentée ? Que représente-t-il ?
(À première vue, il semble que l'histoire parle de la confrontation entre politiques et voleurs, mais si vous regardez plus profondément, ce n'est pas un hasard si Platonov est un scénariste de cinéma intellectuel opposé aux voleurs, c'est-à-dire que la spiritualité s'oppose à la force brute. Mais il existe un autre plan lié au thème « artiste et pouvoir », « artiste et société ». « Presser les romans » - cette expression du jargon des voleurs est elle-même une puissante métaphore satirique : une telle « compression » pour le bien des puissants est une caractéristique ancienne et difficile à surmonter de la littérature, Shalamov a réussi à montrer son attitude négative à la fois envers les « serpents » et envers les « charmeurs ».)
L'histoire "La dernière bataille du major Pougatchev". Valery Esipov, chercheur sur le travail de Shalamov, écrit que "Shalamov n'a pas écrit un seul mot comme ça".
- De quoi parle cette histoire ?
- Pourquoi l’auteur compare-t-il les arrestations des années 1930 et 1940 au début du récit ? En quoi les anciens soldats de première ligne étaient-ils différents des autres prisonniers ?
- Parlez-nous du sort du major Pougatchev. Quel est le sort de ses camarades ? Comment l’expérience de la guerre les a-t-elle affectés ?
- Comment les prisonniers se sont-ils comportés lors de l’évasion ?
- Pourquoi n’y avait-il aucun prisonnier blessé à l’hôpital ? Pourquoi Soldatov a-t-il été soigné ?
- Pourquoi l'histoire se termine-t-elle avec la mort de Pougatchev ?
Quel sentiment reste-t-il après la lecture de l'histoire ? Comment se manifeste l'attitude de l'auteur envers les personnages ? (L'attitude de l'auteur envers les héros est également indiquée par le nom de famille - Pougatchev, et par le fait que l'auteur l'appelle constamment par son grade - major, soulignant qu'il est un combattant qui a défié les autorités du camp, et le sourire du major en se souvenant ses camarades tombés avant sa propre mort. Shalamov dira de lui - "la vie d'un homme difficile", avant sa mort, il lui donnera une airelle insipide, répétera deux fois les mots "les meilleures personnes" et se souviendra de son sourire, éprouvant la joie que il y a une hauteur spirituelle chez une personne.)
Pourquoi Chalamov, qui affirmait qu'il ne pouvait y avoir d'évasion réussie dans la Kolyma, a-t-il glorifié le major Pougatchev ? Quel est l'exploit du major Pougatchev ? (L’exploit de Pougatchev et de ses camarades n’est pas qu’ils aient défendu leur liberté les armes à la main, ni qu’ils aient tourné leurs mitrailleuses contre le pouvoir soviétique, ni qu’ils aient – chacun d’entre eux – préféré la mort à la capitulation. Ils sont devenus des héros parce qu’ils " Ils ont refusé d'accepter le système de pensée et de sentiment qui leur était imposé. Conscients du camp comme un système non humain, ils ont refusé d'y exister. La fuite - du camp vers la taïga - du camp vers le monde - était sans aucun doute un miracle du courage physique, mais surtout de la pensée courageuse.)
Après avoir écrit un conte de fées très important pour l'écrivain personnellement, Shalamov en déduit une nouvelle loi du camp - la loi de la préservation de la personnalité et répond à la question de savoir comment sortir de ce monde de mort. Au moment où Shalamov s'est fixé pour tâche de «se souvenir et d'écrire», il a, comme Pougatchev et ses camarades, mené la bataille selon ses propres règles - de prisonnier, il est devenu écrivain et a transféré la bataille avec l'extra-humain. système vers un territoire culturel étranger au camp et qui lui est originaire.
Professeur: Les gars, avons-nous réussi à nous rapprocher de la résolution du mystère des « Contes de Kolyma ? » Quelles caractéristiques de la prose de Chalamov, appelée « nouvelle prose », retiendrons-nous ?
(Le secret des "Contes de Kolyma" est que, malgré toutes les choses négatives, l'auteur a pu montrer que les gens restent humains même dans des conditions inhumaines, il existe un moyen de combattre ce système - de ne pas accepter ses règles, de le vaincre. avec le pouvoir de l'art et de l'harmonie. Caractéristiques de la « nouvelle prose » Shalamov : documentaire, narration laconique, présence de détails symboliques.)
Essayons de faire des syncwins en groupe sur les thèmes : « Kolyma Stories », « Man », « Varlam Shalamov », afin que vous puissiez exprimer vos sentiments après notre cours.
Devoirs: rédiger une critique d'une des histoires de Shalamov en utilisant la pyramide de la « critique » ; regardez le film "Le Testament de Lénine".
Littérature.
2. Valéry Esipov. « Dissiper ce brouillard » (Prose tardive de V. Shalamov : motivations et problèmes)// www.shalamov.ru/research/92/
3. N.L.Krupina, N.A.Sosnina. Implication du temps. - M., "Lumières", 1992
Varlam Tikhonovitch Chalamov (1907-1982) a passé vingt des meilleures années de sa vie - dès l'âge de vingt-deux ans - dans les camps et en exil. Il fut arrêté une première fois en 1929. Shalamov était alors étudiant à l’Université d’État de Moscou. Il était accusé d’avoir distribué la lettre de Lénine au XIIe Congrès du Parti, le soi-disant « testament politique de Lénine ». Il a dû travailler pendant près de trois ans dans les camps de l'Oural occidental, à Vishera.
En 1937, il y eut une autre arrestation. Cette fois, il s'est retrouvé à Kolyma. En 1953, il fut autorisé à retourner en Russie centrale, mais sans le droit de vivre dans les grandes villes. Shalamov est venu secrètement à Moscou pendant deux jours pour voir sa femme et sa fille après seize ans de séparation. Il y a un tel épisode dans l'histoire « L'Oraison funèbre » [Shalamov 1998 : 215-222]. Le soir de Noël, au coin des fourneaux, les prisonniers partagent leurs désirs les plus chers :
- - Ce serait bien, mes frères, que nous rentrions à la maison. Après tout, un miracle peut se produire», a déclaré le cavalier Glebov, ancien professeur de philosophie, célèbre dans notre caserne pour avoir oublié il y a un mois le nom de sa femme.
- - Maison?
- - Oui.
- «Je dirai la vérité», répondis-je. - Il vaudrait mieux aller en prison. Je ne plaisante pas. Je ne voudrais pas retourner dans ma famille maintenant. Là-bas, ils ne me comprendront jamais, ils ne pourront jamais me comprendre. Ce qui leur semble important, je le sais, n'est qu'une bagatelle. Ce qui est important pour moi – le peu qu’il me reste – ils n’ont pas besoin de le comprendre ou de le ressentir. Je leur apporterai une nouvelle peur, une peur de plus à ajouter aux mille peurs qui remplissent leur vie. Ce que j'ai vu, une personne n'a pas besoin de le voir ni même de le savoir. La prison est une autre affaire. La prison, c'est la liberté. C’est le seul endroit que je connaisse où les gens disaient ce qu’ils pensaient sans crainte. Où ils ont reposé leur âme. Nous avons reposé notre corps parce que nous ne travaillions pas. Là, chaque heure d'existence a un sens.
De retour à Moscou, Chalamov tomba bientôt gravement malade. Jusqu'à la fin de sa vie, il vécut avec une modeste pension et écrivit des «Histoires de Kolyma», qui, espérait-il, susciteraient l'intérêt du lecteur et serviraient la cause du nettoyage moral de la société.
Shalamov a commencé à travailler sur « Kolyma Stories », son livre principal, en 1954, alors qu'il vivait dans la région de Kalinin, où il travaillait comme contremaître dans l'exploitation de la tourbe. Il poursuit son travail en s'installant à Moscou après sa réhabilitation (1956) et le termine en 1973.
« Kolyma Tales » est un panorama de la vie, de la souffrance et de la mort des habitants de Dalstroi, un empire campaire du nord-est de l'URSS, qui occupait une superficie de plus de deux millions de kilomètres carrés. L'écrivain y a passé plus de seize ans dans des camps et en exil, travaillant dans des mines d'or et de charbon, et ces dernières années comme ambulancier dans des hôpitaux pour prisonniers. « Kolyma Tales » se compose de six livres, comprenant plus de 100 histoires et essais.
V. Shalamov a défini le thème de son livre comme « une étude artistique d'une terrible réalité », « le nouveau comportement d'une personne réduite au niveau d'un animal », « le sort des martyrs qui n'étaient pas et n'ont pas pu devenir des héros ». Il a caractérisé les « Histoires de Kolyma » comme « une nouvelle prose, une prose de la vie vivante, qui est en même temps une réalité transformée, un document transformé ». Varlamov se comparait à « Pluton, ressuscité des enfers » [Shalamov 1988 : 72, 84].
Depuis le début des années 1960, V. Shalamov proposait les « Histoires de Kolyma » aux magazines et maisons d’édition soviétiques, mais même à l’époque de la déstalinisation de Khrouchtchev (1962-1963), aucun d’entre eux n’a réussi à passer la censure soviétique. Les histoires ont été largement diffusées dans le samizdat (en règle générale, elles étaient réimprimées sur une machine à écrire en 2-3 exemplaires) et ont immédiatement placé Shalamov dans la catégorie des dénonciateurs de la tyrannie de Staline dans l'opinion publique non officielle à côté de A. Soljenitsyne.
Les rares apparitions publiques de V. Shalamov avec la lecture des « Histoires de Kolyma » sont devenues un événement public (par exemple, en mai 1965, l'écrivain a lu l'histoire « Sherry Brandy » lors d'une soirée à la mémoire du poète Osip Mandelstam, organisée dans le bâtiment de l'Université d'État de Moscou sur les collines Lénine).
Depuis 1966, les « Histoires de Kolyma », une fois à l'étranger, ont commencé à être systématiquement publiées dans les magazines et journaux d'émigrés (au total, en 1966-1973, 33 histoires et essais du livre ont été publiés). Shalamov lui-même avait une attitude négative à l'égard de ce fait, car il rêvait de voir « Kolyma Stories » publié en un seul volume et pensait que les publications dispersées ne donnaient pas une impression complète du livre, faisant de plus de l'auteur des histoires un employé permanent involontaire. de périodiques émigrés.
En 1972, dans les pages de la Gazette littéraire de Moscou, l'écrivain proteste publiquement contre ces publications. Cependant, lorsqu'en 1978 la maison d'édition londonienne « Kolyma Stories » fut finalement publiée ensemble (le volume comptait 896 pages), Shalamov, gravement malade, en fut très heureux. Ce n'est que six ans après la mort de l'écrivain, au plus fort de la perestroïka de Gorbatchev, qu'il devint possible de publier des « Histoires de la Kolyma » en URSS (pour la première fois dans le magazine « Nouveau Monde » n°6 de 1988). Depuis 1989, les « Histoires de Kolyma » ont été publiées à plusieurs reprises dans leur pays d'origine dans divers recueils d'auteurs de V. Shalamov et dans le cadre de ses œuvres de collection.