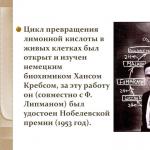Gueorgui Vladimov : biographie. Roman "Le général et son armée". Le général et son armée VI. Les derniers mots du professeur
On m'a demandé d'écrire sur mon père. Malheureusement, nous étions très peu ensemble - seulement une dizaine d'années. Toutes ces années, je n’ai pas pu me débarrasser du sentiment que je devais écrire tout ce dont mon père parlait, que c’était trop important : la mémoire humaine n’est pas fiable. Je ne l'ai pas écrit. Maintenant, j’écris de mémoire, des morceaux pitoyables de ce qui a été imprimé, mais merci qu’au moins ils restent.
Comment et quand l’avons-nous rencontré ? Cela semble incroyable, bien sûr, mais c'est vrai : nous ne nous sommes connus qu'en 1995, lors de la remise par mon père du prix littéraire russe Booker, alors que j'avais déjà trente-trois ans. Avant, il n’y avait que des lettres. Lettres vers l'Allemagne depuis Moscou et retour.
Comment votre père s'est-il retrouvé en Allemagne ?
En 1983, à l'invitation de Heinrich Böll, mon père part donner des conférences à Cologne. À cette époque, il n'avait rien publié en Russie depuis dix ans. Auparavant, il est devenu président d'Amnesty International, a écrit des lettres pour défendre Andrei Sinyavsky et Yuri Daniel, était ami avec Andrei Sakharov, Elena Bonner, Vasily Aksenov, Vladimir Voinovich, Bella Akhmadullina, Fazil Iskander, Bulat Okudzhava, Viktor Nekrasov, connaissait avec Alexandre Soljenitsyne, Alexandre Galich, Vladimir Maksimov, Sergueï Dovlatov, Yuri Kazakov, Yuri Lyubimov, Vladimir Vysotsky et bien d'autres. Peu à peu, il a commencé à vivre «à travers», et les autorités soviétiques ne pouvaient pas tolérer sereinement de telles choses, et encore moins leur pardonner.
Peu à peu, ils ont survécu et l'ont traqué : il a été expulsé de l'Union des écrivains, où il a été admis en 1961 ; puis ils ont commencé à publier des articles calomnieux dans Literaturnaya Gazeta (le principal porte-parole de la coentreprise de ces années-là), qui ont été accueillis avec joie par certains « écrivains » (comme les appelait leur père). Et puis ils ont commencé à surveiller son appartement et les invités qui le visitaient. Mon père écrit à ce sujet en détail dans son histoire « Ne faites pas attention, Maestro ! »
Comment pourraient-ils lui pardonner sa plus profonde indépendance intérieure et son autosuffisance ? Un jour, après son retour en Russie, il m'a dit : « Tu sais, je n'irai pas à ce rassemblement, je ne supporte aucune sorte de fête, pourquoi perdre du temps là-dessus ? Un écrivain doit écrire, pas discuter et sortir. J’ai toujours pensé qu’il n’était pas nécessaire d’adhérer à un parti ou à une association, tout cela n’a aucun sens, c’est pourquoi j’ai toujours été non partisan et libre.
C'est ainsi que mon père a répondu à mon reproche - je lui ai reproché de ne pas aller à une soirée littéraire régulière, où se réunissait l'élite littéraire de ces années-là et où il était invité à l'avance à présenter une statuette de Don Quichotte - « un symbole d'honneur et la dignité dans la littérature ».
Moi, un enfant gâté de la réalité soviétique, je pensais qu'il pourrait y avoir là-bas des « personnes utiles » qui l'aideraient à obtenir au moins un petit appartement de l'État. Après tout, Vladimir Voinovich a reçu un bel appartement de quatre pièces dans Bezbozhny Lane sur ordre de Mikhaïl Gorbatchev !
Comment pourraient-ils lui pardonner, par exemple, son amitié avec Sakharov en disgrâce, alors que ses connaissances reculaient devant lui comme à cause de la peste ? Mon père a essayé d'aider Andrei Dmitrievich d'une manière ou d'une autre à cette époque, agissant même parfois comme son chauffeur. Je me souviens d’un incident drôle (c’est drôle maintenant !) raconté par mon père : lors d’un voyage (à Zagorsk, semble-t-il), la porte du vieux « Cosaque » préféré de mon père s’est soudainement détachée. Et à toute vitesse... Tout le monde se figea. Et Sakharov a calmement tenu la porte malheureuse jusqu'au bout, poursuivant la conversation sur un sujet qui l'intéressait.
Une autre histoire, plus dangereuse, était liée à ce « Cosaque ». Un jour, lors d'un voyage hors de la ville, le moteur de la voiture a complètement calé, et lorsque mon père a regardé à l'intérieur, il a découvert que près d'un kilogramme de sucre cristallisé avait été versé dans le réservoir de carburant, c'est pourquoi la voiture a refusé de bouger. Mon père était sûr que ce n'était pas un accident, cela avait été fait par des employés intéressés du « bugor », comme on appelait alors l'organisation omniprésente responsable de la sécurité de l'État de l'URSS, mais, bien sûr, il n'avait aucune preuve directe. Avec beaucoup de difficulté, il parvint à débarrasser le réservoir de cette boue...
En 1981, après des interrogatoires à Loubianka, mon père a eu sa première crise cardiaque, puis de nouveaux interrogatoires et une allusion à la reprise des interrogatoires. Tout pouvait finir par l'emprisonnement (le vocabulaire des dissidents de l'époque). A cette époque, mon père avait déjà commencé à écrire « Le général et son armée ». Je devais sauver mon entreprise, ma vie. Merci à Bell!
Mais en quittant le pays, mon père ne pensait pas qu'il partirait avant longtemps, un an maximum. Deux mois après mon arrivée en Allemagne, mon père et Natasha Kuznetsova (sa seconde épouse) ont entendu à la télévision le décret d’Andropov le privant de sa citoyenneté. Ils ont vendu l’appartement de la coopérative mère de Natasha avant de partir pour l’Allemagne, et le conseil d’administration de la coopérative a vendu lui-même l’appartement de leur père, sans lui demander la permission.
Grâce à des amis de la maison d'édition Text, qui a publié l'histoire de mon père « Le fidèle Ruslan », j'ai découvert son adresse en Allemagne. Je lui ai écrit. J'ai écrit que je n'avais besoin de rien de lui - je suis déjà une personne bien établie, un médecin, j'étudie aux études supérieures, j'ai un appartement, des amis, mais comme c'est étrange - sur une si petite planète Terre, deux les parents vivent et ne se connaissent pas. Mon père a répondu et nous avons commencé à correspondre. En 1995, il vient à Moscou pour assister au Booker Prize pour son roman Le général et son armée. Il a été nominé par le magazine « Znamya », où des chapitres du roman ont été publiés. Mon père était très reconnaissant envers les employés de Znamya pour avoir été les premiers à contribuer au retour de son travail dans son pays natal. Il souhaitait que son dernier roman, « Long Way to Tipperary », soit publié par eux ; le magazine a annoncé cet ouvrage à plusieurs reprises. Hélas! Seule la première partie du roman fut publiée, après la mort de son père. D'autres restaient dans leurs projets ; il m'a dit quelque chose.
Mon père m'a invité à la cérémonie de remise des prix. Avant cela, je lui ai rendu visite - dans l'appartement de Yuz Aleshkovsky, qui a invité son père à rester avec lui pendant toute la durée de son séjour à Moscou.
Mon père n'avait plus son propre appartement. Il est devenu sans abri. En 1991, Gorbatchev, par décret, a restitué sa citoyenneté, mais pas son logement... Certes, en 2000, la Fondation littéraire internationale des écrivains a fourni à son père une datcha à Peredelkino à louer. Mon père aimait cette datcha, qui n'était pas tout à fait la sienne, mais le Seigneur ne lui permettait pas de jouir de la paix et du bonheur dans son pays natal.
Avant cela, la datcha était vide depuis de nombreuses années, s'effondrant et s'effondrant lentement, quelque chose y fuyait constamment quelque part ; Père a ri et a dit qu'il vivait à « Peterhof avec beaucoup de fontaines ». C'était une maison en brique à deux étages, ressemblant davantage à une caserne, avec quatre entrées. À côté de l’entrée de mon père se trouvaient les entrées où vivaient Georgy Pozhenyan, la fille de Viktor Shklovsky, et son mari, le poète Panchenko. Je ne me souviens pas du troisième voisin.
L'histoire de la datcha était à la fois romantique et triste. Il s'est avéré que cette maison d'écrivain a été construite sur le site de la datcha de l'actrice Valentina Serova. Sa datcha était entourée d'un petit jardin et il y avait un petit étang dans lequel, selon la légende, elle aimait nager. Mon père a dit qu'il imaginait Serova nageant dans un étang avant les représentations et fredonnant doucement quelque chose. Puis il m'a raconté l'histoire de la liaison entre Serova et le maréchal Rokossovsky, au cours de laquelle on aurait demandé à Staline ce qu'il pensait du fait même de cette relation (tous deux étaient mariés). Staline a répondu de manière brève et exhaustive : « Envie !
Après le divorce de Serova et Simonov, la datcha est tombée en ruine ; le Fonds littéraire a démoli la vieille maison et construit une datcha pour les écrivains.
À l’époque de mon père, le jardin était devenu incroyablement grand ; la porte de la cuisine avec une terrasse y ouvrait. Il y avait de grands arbres sombres, l'herbe remplissait tout l'espace. L'étang était recouvert d'une épaisse boue verte, il faisait un peu sombre et des moustiques terriblement voraces volaient. Mon père essayait toujours de faire face à la désolation : il enlevait les branches pourries et les arbres cassés, taillait les buissons, tondait l'herbe ici et là, et le soleil commençait à briller à travers les fenêtres de son bureau.

Au conseil d'administration de l'Union des écrivains de l'URSS
Lorsque mon histoire « Fidèle Ruslan » est apparue et a commencé à se répandre en Occident, avez-vous réalisé tout ce que vous aviez accompli en battant longuement « Trois minutes de silence » - ou votre main était-elle simplement fatiguée ? - vous avez considéré comme une erreur la persécution elle-même et le statut d'"indésirable", que j'ai toujours été pour vous, et vous m'avez appelé à "revenir à la littérature soviétique". Je vois maintenant quel prix j'ai dû payer pour ce retour. Le naïf M. Hölmbakku, voulant vous faire plaisir, écrit qu'il est très satisfait de la traduction de « Ruslan » et des critiques de la presse norvégienne - et quelle épine il enfonce dans vos cœurs de parti ! Eh bien, bien sûr, la politique n'est pas son truc, il ne se soucie pas de l'endroit où apparaît la prose russe - dans « Franges » ou dans « Amitié des peuples » ; là où il voit de la littérature, là vous voyez de la politique et rien d'autre, qui est daltonien ? Je pourrais lui demander de réécrire la lettre d'invitation pour qu'aucun « Ruslan » ne soit mentionné, cela vous conviendrait-il ? - mais pour moi cela signifierait : abandonner mon propre livre ; Je n'accepterai pas l'humiliation. Et puisque vous ne pouvez pas vous séparer de votre nature, et que je ne peux pas me séparer de la mienne, ceci est ma dernière lettre pour vous. Saviez-vous où vous m’appeliez pour « revenir » ? Dans quel coin réservé de soins et d’attention ? Où attendez-vous sept ans pour qu'un livre soit publié après que le premier magazine du pays l'a publié (les enfants nés cette année-là sont simplement allés à l'école et ont appris à lire) ? Où tout éditeur semi-alphabète, et après approbation, a le droit d'exiger des notes, même si elles représentent la moitié du texte (pas une anecdote - des lettres de M. Kolosov) ? Et où un tribunal indépendant dans 90 cas sur cent (et si l'ouvrage a été critiqué dans la presse, alors dans cent cas) prendra-t-il le parti de la maison d'édition d'État et confirmera-t-il dans la décision qu'il faut respecter les limites les « dimensions de l’histoire » ? Les littéraires qui ne connaissent pas ce terme, contactez la juge Mogilnaya - elle le sait ! Ce que vous ne supporterez pas pour le bien du grand lecteur russe - et s'il était nécessaire de le supporter, parlez-lui sous la presse, dans le langage haineux de l'esclave d'Ésope. Bien sûr, tout le monde préférerait être publié dans son pays d'origine, où ses éditions sont distribuées gratuitement, plutôt que d'être traîné en microdoses à travers la frontière la plus fiable du monde, et pourtant - il n'y a pas de problème d'auteurs inédits, il y a un problème de ceux qui n'osent pas publier. Il y a dix ans, dans une lettre au Quatrième Congrès, j'ai parlé de l'avènement de l'ère du Samizdat - et maintenant elle se termine, une autre ère, beaucoup plus longue, du Tamizdat arrive. Oui, cela a toujours été Tamizdat, un pont détesté dans l'océan, sur lequel un pilote fatigué pouvait faire atterrir une voiture lorsque les aérodromes nationaux n'étaient pas acceptés. Mais l'exilé vous a conseillé, mais vous n'avez pas écouté : « Essuie les cadrans ! - votre horloge est en retard », il est temps de ne pas parler du pont - d'îles entières, voire du continent. Et essayez de ne pas compter avec la soif croissante du lecteur qui, contrairement à vous, s'intéresse au texte et non aux données de sortie - il a de moins en moins envie de trier les septième ou huitième exemplaires, il veut avoir un livre. La Russie a toujours été un pays de lecteurs – et un pays qui a été éprouvé dans sept eaux, dans d’innombrables incendies. Ils ne lui ont pas saupoudré la cervelle de quoi que ce soit - des éloges officiels, et des listes de lauréats de Staline tombés dans l'oubli, et des résolutions sur des erreurs idéologiques, et des rapports de vos secrétaires, et toutes sortes d'anathèmes, et le journalisme de « sidérurgistes notables » - et pourtant ils ne l'ont pas complètement poudré ; a survécu, le meilleur de lui-même s'est cristallisé, connaissant la valeur d'un livre honnête et non faux. Ce lecteur, en plus de son devoir principal - simplement lire - a également accepté le tribut imposé par le temps pour préserver les livres de la mort physique, et ils sont confisqués avec plus de soin et de zèle. Il a gardé Yesenin pendant trente ans, jusqu'à ce qu'il attende une réédition, il conserve toujours le Gumilyov dactylographié, il conserve déjà « Ivan Denisovitch » dans la « Roman-Gazeta », il a accepté de conserver « Dans les tranchées de Stalingrad » avec un cachet de la bibliothèque : l'a-t-il lu, volé, supplié ? - mais m'a sauvé du couteau à guillotine. Vous m’avez demandé de « décider », de faire un choix, mais, j’en ai bien peur, ce n’est pas entre Tamizdat et Tutizdat, c’est entre le lecteur et vous. Entre lui, qui gardait mes séries "Novomir", les reliait - sans espoir qu'ils seraient publiés, et dans les flottes du nord - les copiait à la main dans des cahiers - et entre vous, qui ne remplissiez pas les devoirs élémentaires d'un syndicat pour moi. Votre bureau de propagande n'a pas recommandé aux lecteurs de me rencontrer, votre commission juridique n'a pas défendu mes droits, piétinés par la maison d'édition "Russie soviétique", la connaissance de la commission étrangère est complètement épuisée par l'épisode avec l'invitation de " Gildendal". Est-ce qu'il aurait pu en être autrement ? Pourriez-vous vous écarter d’un iota de votre objectif principal ? Tout comme les projets de mouvement perpétuel sont évidemment rejetés, de même toute tentative visant à diriger le processus littéraire devrait être rejetée. La littérature ne peut pas être contrôlée. Mais vous pouvez aider l'écrivain dans sa tâche la plus difficile, ou vous pouvez lui faire du mal. Notre puissant syndicat a invariablement préféré la seconde, ayant été - et restant un appareil de police, dominant les écrivains et d'où se font entendre des exhortations et des menaces rauques - et ne serait-ce qu'eux. Je ne lirai pas la liste de Staline - à qui le syndicat, le véritable conducteur de la mauvaise volonté de ceux au pouvoir, et de sa propre initiative zélée, a d'abord officialisé les affaires, les a vouées au tourment et à la mort, à l'extinction dans des décennies de la non-liberté - c'est trop long, plus de 600 noms - et vous serez justifiés : ce sont les erreurs des dirigeants précédents. Mais sous quelle direction - la précédente, l'actuelle, l'intérimaire - ont-ils « félicité » Pasternak pour le prix, l'ont-ils exilé comme le parasite Brodsky, jeté Sinyavsky et Daniel dans une caserne du camp, brûlé le maudit Soljenitsyne, arraché le magazine des mains de Tvardovsky ? Et maintenant que l’encre d’Helsinki n’est pas encore sèche, de nouveaux châtiments chassent mes collègues du PEN Club international. Pourquoi avons-nous besoin d’une sorte de PEN, alors que nous avons déjà sifflé deux lauréats du prix Nobel ! - et comment ne pas s'exclamer dans les mots du troisième : « Vous avez mis les meilleurs fils du Quiet Don dans cette fosse ! Eh bien, peut-être que c'est suffisant ? Allons-nous reprendre nos esprits ? Devons-nous être horrifiés ? Donc, pour cela, au moins, il faut être Fadeev. Mais en persécutant, en expulsant tout ce qui est agité, rebelle, « faux », étranger au stéréotype réaliste socialiste, tout ce qui constituait la force et la couleur de notre littérature, vous, dans votre union, avez détruit tout principe personnel. Il y en a - que ce soit chez une personne, dans une association - et l'espoir brille : pour un tournant vers le repentir, vers la renaissance. Mais après l'échange de pièces, la position sur l'échiquier a été simplifiée à l'extrême : un pion se termine, gris commence et gagne. C'est la limite de l'irréversibilité : lorsque les destinées des écrivains dont les livres sont achetés et lus sont contrôlées par des écrivains dont les livres ne sont ni achetés ni lus. La grisaille terne, à l'outil de verbiage bien développé, inondant vos conseils, secrétariats, commissions, est dénuée de sens de l'histoire, elle ne connaît que la soif de satiété immédiate. Et cette soif est inextinguible et indomptable. Tout en restant sur cette terre, en même temps je ne veux pas être avec toi. Pas pour moi seul, mais pour tous ceux que vous excluez, « désignés » pour la destruction, pour l'oubli, même s'ils ne m'autorisaient pas, mais, je pense, ne s'y opposeraient pas, je vous exclus - de ma vie. A une poignée de personnes formidables et talentueuses, dont la présence dans votre syndicat me semble accidentelle et forcée, je présente aujourd'hui mes excuses pour mon départ. Mais demain, eux aussi comprendront que la cloche sonne pour chacun de nous, et chacun de nous mérite cette sonnerie : chacun était un persécuteur lorsqu'il a expulsé un camarade - même si nous n'avons pas frappé, mais vous avons soutenu avec nos noms, notre autorité, et notre présence silencieuse. Portez le fardeau des gris, faites ce pour quoi vous êtes apte et appelé à faire – appuyez, poursuivez, ne les laissez pas partir. Mais... sans moi. Je rends le billet n°1471.
Dans la littérature des années 90, il n’y a pas de livre qui représente de manière plus cohérente et plus forte la tradition réaliste russe que le roman de Gueorgui Vladimov « Le général et son armée ». en 2001, lors de la célébration du dixième anniversaire de la création du Booker Prize, de toutes les œuvres récompensées par ce prix depuis dix ans, « Le général et son armée » a été qualifié de plus méritant.
Ce roman a été publié pour la première fois en 1994 (« Znamya », 1994, n° 4-5), mais la version magazine ne contenait que 4 chapitres.
Vladimov essaie de toutes ses forces de convaincre le lecteur qu'il écrit sur la guerre, qui est entrée dans notre mémoire sous le nom de Grande
La guerre patriotique contre les envahisseurs nazis, cette vérité jusqu’à présent déformée par tout et par tout le monde.
Et lorsque le roman « Le général et son armée » a suscité de sévères critiques de la part de Vladimir Bogomolov, qui a accusé Vladimov d'avoir créé une « nouvelle mythologie » dans laquelle il avait déformé la vérité historique sur la guerre patriotique et commis de nombreuses inexactitudes factuelles, Vladimov lui a répondu dans le de la même manière - "c'était - ce n'était pas", "donc - pas comme ça". Mais il est peu probable qu’un tel différend soit directement lié à la fiction : qui se soucie désormais, par exemple, de savoir si l’interprétation de Léon Tolstoï de la situation sur le champ de Borodino correspond ou non aux faits réels ? Il note que vous écrivez sur des événements historiques, créez votre propre « mythologie de l'histoire » artistique - c'est-à-dire que vous recherchez le sens humain de l'histoire, déterminez la valeur des relations avec l'histoire dans le destin d'une personne, dans sa recherche de l'harmonie avec le monde ou dans la perte de cette harmonie. (orientation vers la tradition du récit épique dans l'esprit de « Guerre et Paix » de Léon Tolstoï).
Dans le roman, il y a un conflit entre la liberté et la peur. Chacun des personnages du roman de Vladimov a ses propres idées sur la liberté. Ainsi, l'infirmier Shesterikov associe son rêve de liberté à un terrain qu'il pourra enfin gérer après la guerre. L'adjudant Donskoy voit la liberté dans l'obtention de l'indépendance et rêve donc d'être « transféré » dans un régiment ou une brigade. Et le général Kobrisov lui-même voit sa liberté dans la possibilité d'influencer activement un événement historique. Et le major Svetlookov (un officier du contre-espionnage de l’armée) répand autour de lui la tension électrique de la peur.
La peur est devenue un état constant des gens, ou plutôt une sorte de maladie mentale qui, comme une épidémie, a frappé tout le pays, toute la société soviétique. En outre, souligne Vladimov, le climat de peur est délibérément attisé par les autorités de l'État. En particulier, c’était précisément le but des exécutions publiques dites de « représailles », qui ont commencé à avoir lieu dans les territoires libérés.
« La peur a été chassée par la peur », se souvient le général, « et les gens l'ont chassée, eux-mêmes dans une peur insurmontable de ne pas réaliser le plan, d'échouer la campagne - et d'aller eux-mêmes là où l'homme exécuté s'est retiré.
Ainsi, une suspicion constante, une surveillance et une enquête omniprésentes, la menace de répression qui pèse sur tout le monde comme une épée de Damoclès, une peur éternelle - telles sont les circonstances dans lesquelles se trouvent les héros du roman « Le général et son armée », c'est le une « dépendance » qui limite leur liberté.
Dans une atmosphère de suspicion totale et de peur éternelle de la répression, la personnalité se déforme - elle est frappée par le syndrome de l'esclave.
Quelles sont les conséquences morales de l’atmosphère d’enquête et de peur dans laquelle chacun, des maréchaux aux simples soldats, doit vivre ? Qu'arrive-t-il à l'âme des gens ?
Telles sont les questions que Vladimov pose dans son roman.
Il y a une scène étonnante dans le roman où la mentalité d’esclave est présentée dans toute son essence pathétique et dégoûtante. C'est ici que se déroule l'exécution par le général Drobnis* du major Krasovsky, un des officiers de sa suite. Il était incapable d'exécuter l'ordre du général, et il était impossible de l'exécuter : reconquérir les hauteurs avec une douzaine de soldats épuisés de l'Armée rouge.
Il organise l'exécution de son subordonné - il lui tire dessus de ses propres mains, en utilisant des tirs inexacts d'un faible pistolet Browning et en prolongeant également le tourment de sa victime.
Le général Kobrisov, qui était présent à cette exécution, suggère avec mépris à Drobnis : « Si seulement nous pouvions prendre un mitrailleur et quelques détenus, ils feraient tout avec compétence. Et alors - en quoi se transforme la punition ?.. » Et - il est étonnant que ce ne soit pas Drobnis qui réponde à Kobrisov, mais le tireur lui-même, et il répond « avec une indignation clairement audible : « Ne pensez-vous pas, camarade général, que vous vous mêlez d'autre chose que de vos propres affaires ? Leonid Zakharovich saurait mieux quelle punition m'infliger. Et ce que cela devrait devenir... Alors ne vous embêtez pas, d'accord ? Si je suis coupable, je mourrai aux mains de Léonid Zakharovitch, mais, excusez-moi, je ne veux pas écouter vos maximes !... »
Un esclave, même exécuté par son maître, se lèche fidèlement la main. Voilà ce qu’est la mentalité d’esclave : l’estime de soi d’une personne s’est atrophiée, elle s’humilie humblement devant le pouvoir, elle idolâtre mystiquement ses dirigeants. Cette scène terrible amène le général Kobrisov à une réflexion douloureuse :
« Pitoyable est le petit homme qui confie sa vie à un autre, reconnaissant son droit de la lui enlever ou de la laisser.
Dans cette réflexion du général réside la clé pour expliquer le phénomène du pouvoir totalitaire – le secret de sa force, les mécanismes de gouvernement de chaque citoyen et de la société entière.
Au premier plan du roman «Le général et son armée», se trouvent les commandants de l'armée, les commandants du front, les représentants du quartier général - en un mot, la plus haute élite de l'Armée rouge. Et ce qui est encore plus frappant, c'est que même eux, ceux qui contrôlent l'énorme force militaire, sont touchés par le syndrome de l'esclave - la peur du « Suprême » (comme ils appellent Staline, presque comme une divinité) et de ses organes punitifs, la servilité. à ceux qui sont plus proches du pouvoir le plus élevé, impolitesse, atteignant le point d'impolitesse, devant ceux qui sont plus bas sur l'échelle de carrière
Le conflit principal du roman est de nature morale et psychologique, car il s'avère que l'issue d'une opération militaire majeure dépend en grande partie de la lutte entre les ambitions personnelles des chefs militaires (tout le monde veut obtenir le droit de prendre Predslavl, la « perle de l’Ukraine »). Celui dont les troupes entreront les premières dans Predslavl se verra garantir la gloire, l'honneur, les ordres, les étoiles sur les bretelles et, en général, la réputation d'un commandant exceptionnel. Et commencent des jeux en coulisses dont le but est d'écarter le général Kobrisov, dont le nom est le plus proche de l'objectif souhaité, et de prendre sa place. Mais pour tous ces jeux cachés des généraux, des centaines et des milliers de soldats doivent payer, et au prix le plus élevé : leur propre vie. Mais les commandants eux-mêmes ne pensent pas un seul instant au coût humain des décisions qu’ils prennent. Et le commandant de l'armée Kobrissov, sachant que la prise de Myryatin devra payer la vie de dix mille soldats, n'exécute pas l'ordre de préparer une attaque contre la ville et met ainsi fin à sa carrière militaire, en fait, à sa toute la biographie ultérieure.
Mais pour Kobrisov, le motif de la valeur de la vie humaine revêt un caractère particulièrement poignant et insupportablement grave : Myriatine est défendue par les Vlasovites - des bataillons russes combattant aux côtés des nazis. L'auteur et son héros ne se lancent pas dans de longues discussions sur comment et pourquoi ces gens se sont rangés du côté des envahisseurs. Le plus important ici est que le peuple russe doit lutter contre les Russes.
selon Vladimov, c'est le principal défaut de la conscience d'une société totalitaire : ici la valeur de la vie humaine n'est pas prise en compte, elle est en réalité réduite à zéro ! Et dans une situation de guerre, où leurs subordonnés paient de leur sang toute décision des dirigeants, cette essence sans âme et inhumaine de l’État totalitaire se révèle avec une évidence flagrante. Par conséquent, dans la hiérarchie sociale de cette société, les premiers rôles sont occupés par des gens comme Terechchenko, qui a acquis sa renommée en tant que « commandant offensif » en poussant les gens à l'attaque avec un bâton sur le dos et en leur crachant au visage, indépendamment de la situation. toute perte.
La morale dominante dans l’Armée rouge est le mépris de la dignité de l’homme et de sa vie.
En refusant de capturer Myryatin, Kobrisov s'est opposé pour la première fois de sa vie à la plus haute autorité. Oui, il n'a pas pu sauver de la mort ces dix mille soldats tués près de Myryatin. Oui, il n’a pas pu empêcher un bain de sang entre les Russes. Mais lui, au moins, a pu gérer son sort comme il l'entendait - conformément à sa compréhension de son devoir et de ses droits militaires et humains, et non comme le Commandant suprême lui-même l'exigeait. Le général doit être avec son armée – il doit accepter la honte, la gloire et la mort parmi ses soldats qui lui ont confié leur vie ! - tel est le credo éthique du général Kobrisov. Et il n'a permis à personne de le faire tomber de cette position, acquise au cours d'années de graves tourments mentaux et d'expériences dramatiques d'auto-redressement. Le général perdra inévitablement sa bataille contre la tyrannie. Mais sa défaite est une grande tragédie, car il ne capitule pas devant le mal tout-puissant, devant la force satanique de la tyrannie.
Abattu par ses propres artilleurs, il se trouve absolument seul dans la disposition de ses troupes : il se retrouve général sans son armée, c'est-à-dire sans le peuple, sans son appui.
Vladimov et son héros voient clairement avec quelle habileté Staline manipule « l’opinion populaire ». Et le principal appât avec lequel Staline « l’étranger » soudoie le peuple est un jeu de sentiment national, lorsqu’il faut crier d’une manière très russe, sincère : « Défendons la Patrie ».
À la lecture du roman de Vladimov, l’idée s’insinue que vaincre la tyrannie, qui s’appuie sur l’amour-peur de ses esclaves, est incroyablement difficile, voire impossible. Car les esclaves, à qui non seulement l'estime de soi a été enlevée, mais aussi la compréhension de la valeur de la vie humaine a été réduite à des niveaux microscopiques, iront sans aucun doute, sur les ordres de leurs tyrans, dans n'importe quel abîme, le remplissant de leurs corps vers le haut pour que les dirigeants puissent les traverser.
Mikhaïl Nekhoroshev
Il a été demandé à Grigori Baklanov quels livres sur la guerre il considère comme les meilleurs. L'écrivain a cité trois ouvrages : « Dans les tranchées de Stalingrad », « Vie et destin », « Le général et son armée ». En fait, le sujet de discussion ne pouvait être que le roman de G. Vladimov « Le général et son armée ». Le temps des critiques, je crois, est déjà révolu, mais il convient de réfléchir à la raison pour laquelle Baklanov a inclus ce livre parmi les trois premiers gagnants absolus.
Bien sûr, ce n’est pas parce que Vladimov a écrit un roman de « général », comblant une certaine lacune dans le thème militaire : il y a une prose de « soldat » et de « lieutenant » d’un niveau remarquable, mais il n’y avait pas de prose de « général ». Racontant le sort du général Kobrisov et introduisant naturellement d'autres chefs militaires dans le récit, Vladimov n'écrit pas quelque chose comme des rapports d'état-major, ni de l'histoire sous la forme d'une série de dates, mais parle des leviers et des ressorts qui ont déclenché les événements. Nous avons déjà lu de nombreux livres sur la guerre, nous savons comment nous nous sommes battus, mais il faudra beaucoup de temps pour répondre à la question de savoir pourquoi il en est ainsi. Oui, la compagnie s'est tenue sur une hauteur sans nom jusqu'au dernier, les soldats et les commandants sont morts de la mort des braves, et puis il s'est avéré : les obus n'ont pas été livrés, les communications n'ont pas été étendues, les unités de réserve ne sont pas arrivées à temps ou ne sont pas arrivés du tout là où ils étaient attendus - mais de quel genre d'obsession s'agit-il ? Pourquoi donc? En 1941, les milices moscovites, presque désarmées, périssent sous les bombes et les chars allemands. Mais en 1943, nous avons attaqué avec notre expérience de la guerre, notre supériorité en effectifs et en équipement, et nous avons gagné, comme auparavant, en utilisant la tactique des « quatre couches russes » : trois couches de soldats tomberont dans le sol - la quatrième les attaquera. Pourquoi en était-il ainsi en 43, et même en 45 ! - c'est notre secret militaire.
Voici les commandants de l'armée discutant du plan de prise de Kiev (dans le roman - Predslavl). Ils discutent du moment où l'armée de Kobrisov a déjà « habité » la tête de pont Myryatinsky sur la rive droite du Dniepr, où deux passages ont été établis, un câble de communication a été posé, les positions allemandes ont été ciblées et l'armée elle-même est déjà à douze kilomètres de la ville avec une aile. Tout ce qu'exige l'art militaire a été fait, vous pouvez prendre la « perle de l'Ukraine », en laissant la ville de Myryatin aux Allemands, ce n'est pas lui qui décide de l'affaire. Et les Kobrisov auraient convaincu le maréchal Joukov, mais ils ont choisi le mauvais argument : ils disent qu'ils ont pitié du peuple, mais pour cette ville, où il y avait environ dix mille habitants avant la guerre, ils devront payer le même montant. "Eh bien, demandez des renforts", dit le maréchal. La remarque est courte, quotidienne, sans intonation, ce qui veut dire que c'est toujours comme ça, c'est la règle non écrite. Et le maréchal Joukov, sans aucun doute, sait mieux se battre que beaucoup de ses généraux, et qu'il ne veut pas et n'a jamais voulu savoir combien de soldats mourront, il y a une raison à cela : le principal commandant soviétique cela ne pouvait pas être différent, nous n'avions besoin de personne d'autre, nous faisions tout - « à tout prix ». Tel qu’était notre monde, la guerre aussi.
Vladimov, un auteur économique, a laissé entendre qu'il y avait un projet de prise de la ville d'ici le 7 novembre, mais tous les lecteurs ne remarqueront pas une telle bagatelle. Mais dans tout ouvrage historique, on trouve des lignes fières : « Le travail politique des partis a été mené sous le slogan « Nous libérerons Kiev d’ici le 26e anniversaire de la Grande Révolution d’Octobre ». Il est impossible d’expliquer ce que le plus grand anniversaire a à voir avec la tactique militaire, mais telle était l’idéologie, telle était la ligne du parti. Idéologie égoïste. Elle a exalté ceux qui prenaient des villes pour des anniversaires, et non ceux qui voulaient sauver les gens. Cette source a beaucoup déterminé pendant la guerre, et seules les sources de l'enquête secrète pouvaient égaler sa force : des départements spéciaux de toutes sortes. La guerre patriotique d’un État totalitaire – c’est ainsi qu’on appelait cette situation paradoxale. Il est donc paradoxal que ces États s’attaquent généralement eux-mêmes et que la guerre pour la patrie ne les regarde pas. Et il s’est avéré qu’en attaquant pour la patrie, les soldats sont morts à la fois pour Staline et pour le régime soviétique. Ce régime qui détestait son peuple et le craignait plus que toute autre chose. Et si ces lignes indignent quelqu’un, ce sera certainement le cas ! - alors je répondrai qu'il vaudrait mieux s'indigner des agissements de notre commandement, par exemple avec l'ordre d'état-major n°270 du 16 août 1941. L’ordre est long, mais son essence est courte : nous n’avons pas le mot « prisonnier de guerre », mais le mot « traître ». Et il y avait, selon les estimations les plus prudentes, au moins quatre millions de ces « traîtres » pendant la guerre.
La figure du général Vlasov occupe une place particulière dans le roman. Les critiques soit se taisent, soit parlent brièvement et reprochent parfois à l'auteur le flou de ces pages. Eh bien, cela se comprend : le début de la contre-offensive près de Moscou est décrit avec de nombreux détails précis, mais au centre de l'épisode se trouve un général, parfois charnu, parfois brillant avec une certaine vision. Une stature puissante, « un visage masculin merveilleux », il marche « sans chichi, d'un pas grand », « le calme et la confiance » émanent de lui - il s'agit de lui. "Le visage était difficile, en partie souffrant", un observateur avisé aurait remarqué chez lui "une tromperie qui échappait aux autres", "il a éprouvé la peur de la captivité, qui ne s'est pas apaisée encore maintenant" - et tout cela tourne autour de lui aussi. Le général a de nombreux visages, changeants et même pas de nom de famille. Mystère général. Eh bien, c'est vrai. Nous savons à propos de Vlasov qu'il est un traître qui a servi les Allemands, mais il n'y a aucun mot sur le genre de chef militaire soviétique qu'il était. C’est comme s’il était né général et s’était immédiatement précipité vers les Allemands. L'auteur n'a pas prétendu être un clairvoyant, n'a pas construit de versions sensationnelles et n'a même pas écrit de personnage, mais seulement des traits pour le portrait.
Il y avait aussi une postface à la conversation sur Vlassov et les prisonniers. Trois mois après la publication du roman, deux articles parurent (toujours dans Znamya) : L. Reshin « Collaborateurs et victimes du régime », G. Vladimov « Nouvelle enquête, ancienne phrase ». Reshin a écrit un article basé sur des documents des archives du FSB, parmi ceux, bien sûr, auxquels il était autorisé, mais il a ajouté quelques faits à nos maigres informations, pour lesquels nous vous remercions. Les conclusions de Reshin sont traditionnelles et donc sans intérêt, et jongler avec les chiffres est depuis longtemps devenu ennuyeux. Dans l’article de Vladimov, je crois, le plus important n’est pas la polémique avec Reshin, mais le discours direct de l’auteur qui a dit cela. Vlassov, bien entendu, n’est pas un combattant contre le régime, mais plutôt un aventurier, « un homme de la minute, pas de l’heure », et ne peut prétendre au rôle de chef de la « troisième force » (contre Staline). et Hitler en même temps). Quant aux soldats qui ont rejoint le ROA, nous ne parlons bien sûr pas de justifications de trahison, mais de quelque chose de complètement différent. "La tragédie des désespérés, qui ont perdu tout espoir de trouver un langage puissant autre que le fusil et la mitrailleuse, qui se sont battus contre leur patrie, tout comme ils se sont battus contre eux-mêmes, en décidant de se suicider", voilà ce que dit l'âme de Vladimov. faire mal. Et l’idée d’une « troisième force » – une alliance possible mais ratée entre Vlasov et un général comme Guderian, me semble généralement être une utopie politique. À ce moment historique, tous ceux qui pouvaient influencer les événements remplissaient déjà l’arène politique. Il n’y avait tout simplement pas d’espace libre là-bas.
Et c'est bien que dans le roman il n'y ait pas de mot sur la « troisième force », mais il y a Guderian, qui veut comprendre d'où ce pays tire sa force de résistance et pourquoi ce qui se passe ici n'est pas une guerre de deux armées, mais autre chose. Peut-être que « Fleet Heinz », le stratège et tacticien de la Panzerwaffe, a vraiment lu « Guerre et Paix » le soir où il a signé le premier ordre de retraite de sa vie - mais est-ce là le point ? Si Guderian avait lu ne serait-ce que tous les classiques russes, il n'aurait pas fait un pas de plus vers le secret du légendaire char T-34. Et le secret était simple et naïf : "Cela a été fait par des ennemis du peuple, ce qui signifie qu'ils ont travaillé consciencieusement et, surtout, dans la clandestinité... Nous avons autant de patriotes de ce type qu'il nous faut." Cela ne s’explique pas, c’est un axiome du système soviétique : défendre la patrie avec les mains des « ennemis du peuple ». « C’est notre douleur, la nôtre et celle de personne d’autre. » Et presque tout le monde pendant la Grande Guerre patriotique en était sûr : après la guerre, ce serait différent. Il existe de nombreuses preuves de cela. Et peut-être que Guderian a vraiment compris qu'à l'automne 1941, l'armée allemande « n'était plus combattue par le soviet des députés avec son renforcement et son intensification de la lutte des classes, mais par la Russie », mais qu'importe Guderian ?
Lorsque L. Anninsky (« NM », n° 10, 94) demande pourquoi nos soldats ont accepté de « mourir pour n'importe quel terrain, même celui qui n'a pas de signification stratégique », ce n'est même pas une question rhétorique, mais simplement une question figure de style. L'importance des hauteurs anonymes et des petits villages était déterminée par ces mêmes commandants, maîtres des rapports de victoire, qu'Anninsky appelait à juste titre « bouchers ». Et les soldats sont morts par espoir. Ce qui s’est passé lorsque les gens ont perdu espoir a déjà été raconté. Franchement, je mentionne Anninsky uniquement parce qu'il a lu le roman de manière adéquate, lu ce qui a été écrit (et nous verrons que ce n'est pas du tout la règle) et a intitulé sa critique par une citation clé : « Sauver la Russie aux dépens de la Russie. » Il a écrit : « Je veux donc savoir d’où vient notre inclination fondamentale vers un tel principe de rétribution. » Eh bien, nous pouvons parler sans fin de fondamentalité et de mentalité, les questions éternelles n'ont pas de réponse, mais dans ce cas, je crois, il y avait une « circonstance » décisive : le principe de rétribution a été déterminé par le gouvernement soviétique.
Et le premier article de journal le plus détaillé a été rédigé par Natalya Ivanova (« Znamya », n° 7, 94). Ce qui est gratifiant dans ce matériel, tout d’abord, c’est que le critique écrit beaucoup sur le langage, le style et d’autres choses qui sont étrangement démodées dans les publications littéraires d’aujourd’hui. Natalya Ivanova note que le roman est à plusieurs niveaux, « lisible à plusieurs niveaux », que cette œuvre est traditionnelle au sens le plus élevé et que le roman fait écho non seulement à Tolstoï et Gogol, mais aussi à des motifs folkloriques. Et tout serait merveilleux, mais voici ce qui est étrange : l’article commence par des réflexions sur le poème de Brodsky « Sur la mort de Joukov » et un bon tiers du texte lui est consacré. Et il a fallu une immense introduction pour déclarer Brodsky, puis Vladimov, libérés « d’un schéma antisoviétique trop simple ». Plus tard, il y aura une conclusion : "Vladimov cherche une excuse pour Kobrissov - comme Brodsky cherche une excuse pour Joukov." Bien sûr, la littérature n’est pas une table de multiplication ; les romans sont alors écrits pour aller au-delà du « simple schéma », mais je ne peux pas souscrire à la conclusion de Natalia Ivanova. L'affrontement entre Kobrisov et Joukov est l'un des axes principaux du roman, la question même du principe de rétribution. L'auteur n'a cherché aucune excuse pour Kobrisov et ne l'a pas non plus présenté comme un chevalier sans crainte ni reproche. Kobrisov est l'un des rares à avoir compris ses péchés et à essayer de les expier au mieux de ses capacités, tandis que Joukov - tant dans le roman que dans la vie - n'a compté aucun péché. Un tel mot n'existait pas dans son vocabulaire.
À la fin, Natalia Ivanova déclare : « Même Viatcheslav Kondratiev, même Boulat Okoudjava, qui a combattu et versé le sang, n'a pas pu surmonter la pression idéologique du sujet d'actualité et a finalement douté de la grandeur de la Guerre patriotique. « Une guerre entre deux systèmes totalitaires… » Il me semble que nous devons ici être plus prudents dans nos évaluations, sinon un « schéma simple » aboutira. Ensuite, V. Grossman, qui a écrit sur la parenté des systèmes totalitaires, devrait être considéré comme le premier à en douter. Et au cours de l’année écoulée, Viktor Astafiev, Grigori Baklanov, Vasil Bykov et Yuri Levitansky ont parlé de la même chose dans diverses publications, et aucun d’entre eux n’a douté de la grandeur de l’exploit du peuple. Nous n'avons pas gagné grâce à cette puissance, mais malgré elle - c'est de cela dont nous parlons, c'est à cela que nous arrivons définitivement après une solide réflexion. C’est de cela que parle le roman de Vladimov.
La critique la plus originale a été rédigée par V. Toporov (« Smena », 27 octobre 1994), qui a rappelé dès les premières lignes que le roman avait été annoncé il y a quatre ans, mais « n'était pas sorti sous l'écrivain militaire Baklanov ». Lecteur, rappelez-vous : Baklanov, en tant qu'éditeur, n'a pas approuvé tout dans le roman, mais il a « démissionné » - et c'est le résultat. Toporov n'est pas un astrologue et n'était pas obligé de deviner ce que Baklanov dirait le 8 mai 1995, mais des indices significatifs qui ne sont même pas proches de la vérité ne feront que désorienter le lecteur. Cependant, la manière extravagante du critique est bien connue, il serait possible de ne pas y toucher, puisque Toporov a parfaitement compris l'essence du roman, mais ne l'a pas accepté. Kobrisov est « un général allemand typique », et en général, cette image est « dans l'ensemble encore fausse » - c'est-à-dire une erreur de calcul artistique de l'auteur, qui a vécu trop longtemps en Allemagne. Si Toporov avait consulté des ouvrages de référence, il aurait appris que Kobrisov n'est même pas une image, mais presque une photographie d'un véritable prototype, le héros de l'Union soviétique N.E. Chibisov, qu'il est tout simplement indécent de qualifier d'Allemand. Mais Toporov n’imagine vraiment pas un général soviétique qui combat non pas avec le nombre, mais avec habileté, et c’est pourquoi il ne regarde pas les ouvrages de référence. La Russie, écrit Toporov, selon les règles de la stratégie, a toujours perdu, mais a remporté des victoires quand « elle n'a pas supporté le prix » et, par conséquent, a mis le sort de l'armée et du pays entre les mains de chefs militaires comme Joukov - et plus particulièrement Joukov.
Dans cette discussion conceptuelle, je propose d'écouter l'opinion d'un autre auteur - Viktor Astafiev. Il semble être une personne qui n'est pas proche de Vladimov, ni dans le destin, ni dans son style d'écriture, ni dans les intrigues des livres, mais si l'on ne compte pas par les grades militaires et les positions des personnages, alors « Maudit et tué » est une question de ton ; c'est la même chose que parle de "Général..." Déjà la publication du premier livre du roman ("Devil's Pit", "NM", n° 10-12, 92) a provoqué un choc parmi le public des lecteurs. Dire que ce n’est pas vrai est difficile à dire, mais si c’est vrai, vos cheveux se dresseront et il n’y aura pas de mots. Le régiment de réserve, la fosse du diable - bien sûr, l'enfer, mais d'une manière très quotidienne, même si c'est un petit détail, mais familier à tout lecteur. Des recrues kazakhes en uniforme d'été, nourries de tout ce qu'elles ont pu sur la route, sont amenées à Berdsk en plein hiver, à moitié mortes, certaines simplement mortes. Les soldats pourrissent dans les casernes, transformant les futurs défenseurs de la patrie en crétins. Bon, disons qu'au front, ils ne se souciaient pas du prix, mais ici, pourquoi détruire les gens pour le plaisir ? Pas pour le plaisir, mais parce que. Parce que même dans la vie civile, le prix de notre homme est d'un centime, voire moins. Sur les mensonges des départements politiques, sur le « travail » des officiers spéciaux qui s'efforcent de faire de chacun un informateur - tout est naturellement comme chez Vladimov. Ici, soldats et généraux sont égaux : tout le monde a besoin de surveillance. Mais l'un des soldats considérait le lieutenant Shusya comme un Allemand - "pour sa propreté". "Parce qu'il n'avait jamais vu de véritable officier russe, il est devenu plutôt un punk", a répondu Shus. (C'est dommage que Toporov ne se soit pas souvenu de ces lignes lorsqu'il a écrit sur Kobrisov.) Et encore une chose. Les critiques citent souvent l'histoire de l'exécution des frères Snegirev comme exemple de cruauté insensée. C'est vrai, mais pour moi, la scène absolument quotidienne n'est pas moins puissante : un grand général est venu avec une inspection, est venu dans la salle à manger, a crié d'un ton menaçant : « Vas-tu voler un soldat ? - mais dès les premières lignes il est clair que même si vous criez, même si vous tirez, tout restera comme avant, car tout repose sur ce vol.
Astafiev travaille à ce roman depuis longtemps, depuis l'époque où la vérité était strictement dosée par les autorités de contrôle. Heureusement, ses lettres à Viatcheslav Kondratiev de 1982 à 1987, publiées dans LG (26/10/94), ont été conservées. La correspondance personnelle, même entre grands écrivains, peut être, disons, médiocre, mais voici un journalisme brillant, une opinion sur nos stratèges, acquise à la dure : « Des commandants sans talent, qui avaient complètement oublié comment valoriser la vie elle-même, jonchaient les soldats comme du sable. , et je me suis disputé ! Et plus loin : « Et entre nous, celui qui « parviendra à Joukov » sera un véritable écrivain russe... Lui, lui et le camarade Staline ont brûlé le peuple russe et la Russie dans le feu de la guerre. Nous devons commencer à parler de la guerre avec cette lourde accusation, et alors la vérité viendra.» Veuillez noter que le « différend » entre Astafiev et Toporov ne porte pas sur des faits, mais sur des concepts. Selon Toporov, il s'avère que tel est notre destin historique et qu'il n'est pas nécessaire de dire du mal du héros national Joukov. Si, selon Astafiev, le gouvernement qui a de tels héros est immoral, il ne faut pas leur ériger de monuments, mais apprendre à vivre comme un être humain au moins aujourd'hui.
Mais les débats littéraires et philosophiques ne font pas tout. Dans une société où l’harmonie civile n’est pas souvent rêvée, on pourrait s’attendre à une sévère réprimande, mettant à leur place des critiques malveillantes. Non pas les extravagances de Toporov, mais un coup puissant et complet - à la guerre comme à la guerre, sans cérémonie. Cest ce qui est arrivé. Le jour du 50e anniversaire de la Victoire, apparemment comme cadeau de fête, Book Review a publié des fragments du livre « Les vivants, les morts et la Russie ont honte... » qui, comme indiqué dans la note éditoriale , est consacré aux publications « dénigrant la guerre patriotique ». Il n'y a pas encore de liste de critiques malveillantes, mais les fragments font jusqu'à six pages ! - ils paient à la fois l'écrivain Vladimov et ses personnages. Bref, le roman est une manipulation des faits, un analphabétisme historique, l'imagination d'un homme qui n'a jamais senti la poudre à canon, mais qui sympathise avec les traîtres et autres canailles. Calomnie, dit-on. Et si un commandant à la retraite avait attaqué Vladimov, tout serait en ordre. Voici le maréchal D.T. Yazov (le dernier ministre de la Défense de l'URSS, membre du Comité d'urgence de l'État, etc.) s'est exprimé dans la presse à propos du roman de V. Astafiev avec un simple mot obscène (les journaux n'ont inclus timidement que la première lettre), et il n'y a pas des questions. Ici, le cas est différent : l'auteur de la publication est Vladimir Bogomolov, soldat de première ligne et écrivain, le même, semble-t-il, que Baklanov, Kondratiev, Astafiev, mais il s'est avéré que non, pas le même.
Il est facile d’imaginer que le matériel de Bogomolov a produit une impression forte, voire stupéfiante. Et il est peu probable que le lecteur stupéfait ait remarqué un détail important : Bogomolov écrit immédiatement sur le roman « Le général et son armée », sur l'article « Nouvelle enquête, ancien verdict » et sur bien d'autres choses qui sont tout à fait indirectement liées au roman. . Très probablement, Bogomolov pensait que Guderian et Vlasov étaient les héros préférés de Vladimov, qu'ils étaient représentés presque comme des anges et, en général, qu'ils étaient les personnages principaux du roman. Disons que c'est absolument faux, mais Bogomolov l'a lu de cette façon - il a raison. Et le problème n'est pas qu'il a dérivé sa position d'une impression émotionnelle, mais qu'il a décidé de justifier cette position avec des documents et a commencé à citer des éléments de la vie de Guderian et Vlasov, prouvant, bien sûr, à quel point ils étaient des canailles. La littérature passe alors au second plan, laissant la place à l’histoire. Et si Bogomolov reproche à Vladimov de ne pas connaître les documents, rappelons-nous tout ce qui a été publié aujourd'hui pour ne pas avoir d'ennuis.
Par exemple, on cite l’ordre de Guderyan du 22 décembre 1941 – alors que les Allemands se retiraient sur tout le front – exigeant « de brûler toutes les colonies abandonnées ». L'ordre, c'est le moins qu'on puisse dire, est cannibale, mais un mois plus tôt, alors que nos troupes se retiraient, il y avait l'ordre du commandement soviétique n° 0428 du 17 novembre 1941, commençant par les mots : « Détruisez et brûlez jusqu'au sol. toutes les zones peuplées à l'arrière des troupes allemandes... « Et la population de ces points, où peut-elle aller en plein hiver ? - les détachements de sabotage exécutant cet ordre auraient difficilement pu être accueillis, c'est pourquoi les Soviétiques ordinaires ont remis Zoya Kosmodemyanskaya aux Allemands. Alors jugez par vous-même des ordres... Guderian, écrit Bogomolov, est également dégoûtant parce qu'il a brutalement réprimé l'insurrection de Varsovie en 1944. C’est vrai, on n’érige pas de monument pour de tels actes, mais que faisions-nous à ce moment-là ? Je ne citerai pas un traître-transfuge, mais l'écrivain Ovid Gorchakov, qui a traversé la guerre comme officier du renseignement : « Quand Varsovie brûlait, nous étions intéressés... Staline était intéressé... » Publié dans Komsomolskaïa Pravda en janvier. 13, 1995 avec un tirage de plus d'un million d'exemplaires... Heinz Guderian était général pendant la Seconde Guerre mondiale, et discuter de sa moralité est une chose étrange à faire. Mais si nous discutons, rappelons-nous la règle : tout se sait par comparaison. Et une dernière chose. Vladimov a décrit correctement la surprise de Guderian lors de sa rencontre avec le char T-34 - Guderian connaissait très bien nos autres chars. Il s'est avéré qu'il a étudié les bases de l'art des tanks au centre secret Kama de Kazan.
Parlons maintenant de Vlasov. Nous, écrit Bogomolov, avions 183 commandants d'armées interarmes, « plusieurs ont été capturés » (combien et pourquoi ?), et un seul, Vlasov, est entré en service chez les Allemands. Il y a une magie évidente dans les chiffres et les positions militaires, mais que se passe-t-il si ce n’est pas le commandant de l’armée ? Si le commissaire de brigade Zhilenkov, membre du Conseil militaire de la 32e armée, ou le commandant de brigade Bessonov, ancien chef du département d'entraînement au combat de la Direction principale des troupes frontalières et intérieures du NKVD de l'URSS, ou le général de division Blagoveshchensky, chef de l'École de défense aérienne navale de Libavsk - enfin, sans compter tous ces «associés» de Vlasov dans la ROA, bien que, par leur grade et leur poste, ils ne soient pas non plus, vous le savez, des sergents de réserve. (Informations tirées d'un article de L. Reshin, et Bogomolov n'a pu s'empêcher de le lire.) On pourrait se demander pourquoi Vlasov n'était pas seul ! Mais Bogomolov a sa propre tâche : prouver que Vlasov ne commandait pas du tout la 20e armée près de Moscou, mais qu'il n'était inscrit qu'à ce poste. D'après des données d'archives, que Bogomolov raconte sans citations ni références ! - De fin novembre au 21 décembre 1941, Vlasov souffrait d'une «inflammation purulente sévère de l'oreille moyenne», était à l'hôpital et l'armée était commandée par le chef d'état-major L. M. Sandalov. Vlasov est apparu pour la première fois au poste de commandement de l'armée le 19 décembre dans le village de Chesmeny (rappelez-vous cette date !), c'est-à-dire la veille de la prise de Volokolamsk. Vlasov ne pouvait pas être à Lobnia début décembre, comme le décrit le roman. Et en général, la 20e armée est la plus faible de toutes celles qui ont participé à la bataille de Moscou.
La version de Bogomolov ressemble à un roman policier fringant et pour cette raison. Après avoir lancé une deuxième attaque contre Moscou le 16 novembre, les troupes allemandes à la fin du mois ont couvert la ville en semi-anneau, concentrant les groupes d'attaque dans les directions sud et nord. Dans la nuit du 29 novembre, dans la région de Yakhroma, l'ennemi a traversé le canal Moscou-Volga sur la glace (menace d'encerclement par l'est !), et cette percée n'a été liquidée qu'un jour plus tard. Le 30 novembre, l'état-major décide de lancer une contre-offensive dont le succès n'est pas du tout évident. Le coup principal est porté sur l'aile droite du front occidental (direction nord, nord-ouest), où l'ennemi se trouve à 25-30 kilomètres de Moscou. L'opération commence avec la 1re armée de choc (V.I. Kuznetsov), la 20e armée (A.A. Vlasov), la 16e armée (KK Rokossovsky) et plus tard la 30e armée (D.D. Lelyushenko). Toutes les sources ouvertes (monographies, mémoires, documents) s'accordent sur le fait que la plus grande responsabilité était la 20e armée, quittant la région de Bely Rast-Krasnaya Polyana.
Alors, peut-on imaginer que l'armée la plus faible, prise dans la réserve de l'État-major, soit envoyée au point le plus critique du front, et qu'un général gravement malade soit nommé pour la commander ? Avons-nous un sanatorium sur le front ? Ou est-ce que Staline, Joukov, tout l'état-major - tous ensemble et soudainement ont bougé dans leur esprit ?
Et, disons, ils l'ont nommé - ils pensaient qu'il irait mieux bientôt, et le général était donc en règle. Et il continue de tomber malade. Alors désignez-en un autre, le temps presse ! Du 1er au 5 décembre, c'est une lutte d'initiative, les colonies changent de mains. Le 1er décembre, le 3e groupe de chars ennemi fait une percée le long de l'autoroute Rogachevskoye et s'approche de Lobnya. Le 2 décembre, le flanc droit de la 16e armée se retire au-delà de Kryukovo. (D'ailleurs, le 2 décembre, le commandement allemand pensait que nos réserves étaient épuisées, il n'est donc pas nécessaire de commenter la gravité de la situation.) La 20e armée participe activement aux combats, bien que la pleine concentration de ses les unités se terminent le 4 décembre. La véritable contre-offensive débute le 6 décembre avec le mouvement du 1er choc et de la 20e armées en direction de Klin-Solnechnogorsk. Les forces ennemies sont encore nombreuses, la résistance est désespérée. Krasnaya Polyana et Bely Rast n'ont été reprises aux Allemands que dans la matinée du 8 décembre. L'armée n'a avancé que de 4 à 5 kilomètres, mais ce fut un tournant. (C'est lui qui est décrit dans le roman.) Le 12 décembre, la 20e armée libère Solnechnogorsk et le 20 décembre, avec la 16e armée, Volokolamsk. En regardant la carte, il est difficile d’imaginer que l’armée la plus faible aurait pu accomplir tout cela.
Pour ceux qui souhaitent vérifier ces informations, je recommande les mémoires des maréchaux G.K. Joukov et K.K. Rokossovski. Cependant, dans le livre de Bogomolov « La Minute de vérité », il est également mentionné qu'« à l'heure décisive » « de nouvelles réserves furent introduites près de Moscou, en particulier deux nouvelles armées concentrées au nord de la capitale, ce qui fut une surprise totale pour le gouvernement. Allemands." Cela a été dit, comme vous le voyez, avec respect, et le lecteur attentif lui-même a déjà deviné qu'il s'agit du 1er choc et de la 20e armées. Et pourquoi Bogomolov a maintenant changé de point de vue est une question pour les médiums qui savent lire dans les pensées.
Voyons maintenant ce qu'écrit le témoin principal, le chef d'état-major de la 20e armée L.M. Sandalov, dans le livre « Sur la direction de Moscou ». Le 29 novembre, lors d'un appel urgent, il arrive à l'état-major chez B. M. Shaposhnikov, reçoit des informations sur la situation au front et une nomination au poste de chef d'état-major. Il demande qui est le commandant ? Il y a un commandant, mais il est malade. « Dans un avenir proche, vous devrez vous en passer. Cependant, coordonnez toutes les questions importantes avec lui », explique Shaposhnikov. (Les interlocuteurs s’obstinent à ne pas prononcer le nom de famille du commandant.) Et surtout, cela reste un mystère : Sandalov a-t-il suivi les instructions de Shaposhnikov ? avez-vous consulté le commandant ? On lit : "Dans la nuit du 2 décembre, le commandement de l'armée avec les chefs des branches militaires et la plupart des états-majors de l'état-major et du département politique de l'armée se sont rendus auprès des troupes pour organiser une contre-attaque." (Lecteur, c'est exactement le NP à Lobnya et ce moment que nous connaissons grâce au roman !) Et j'aimerais aussi savoir qui est le « commandement de l'armée » ? Inconnu. Sandalov, qui est généralement généreux avec les noms de famille, n'en a nommé aucun ici ! (Peut-être avait-il peur de le laisser échapper ?) En tout cas, L. M. Sandalov savait exactement ce qui pouvait être écrit dans ses mémoires et ce qui devait être omis. Ni avant ni après la date « légendaire » du 19 décembre, il n'y a pas un mot dans le livre de Sandalov sur le commandant : il a flashé une fois à Chesmeny - avec des lunettes noires et des capes et même avec son nom de famille ! - et a disparu sans laisser de trace. Vlasov commanda la 20e armée jusqu'à la mi-mars 1942, mais ne figura jamais dans les pages du livre. Comme vous pouvez le constater, Sandalov a écrit son roman policier bien avant Bogomolov (1970), mais les deux versions sont étonnamment proches.
Il semble que nous ayons affaire à une légende soigneusement préparée. Ni Sandalov ni Bogomolov n'ont une seule référence à des sources en ce qui concerne Vlasov (dans d'autres endroits - s'il vous plaît). Bogomolov mentionne des conversations téléphoniques dont les enregistrements sont conservés dans les archives. Où exactement? Ce serait bien de fournir des détails : archive... fonds... inventaire... dossier... fiche... L'auteur de « La Minute de Vérité » connaît très bien la valeur d'un document, rappelez-vous comment son détective le travail des héros : « Sceau... Date... Encre... Mastic de tampon... La texture du papier... La signature du commandant de l'unité... est naturelle... » Et ici, ce n'est pas le cas. Entraînez-vous pour être « naturel » ! Non seulement la description de l'épisode du 19 décembre par les deux auteurs est proche dans l'intonation et dans beaucoup de détails, mais Bogomolov a deux phrases entre guillemets, comme tirées des archives, mais là encore sans indiquer la source : « le commandement du front est très mécontent de la lenteur de l'avancée de l'armée », et « le général d'armée Joukov a souligné le rôle passif du commandant de l'armée dans la direction des troupes et exige sa signature personnelle sur les documents opérationnels ». Cela ressort naturellement du livre de Sandalov (p. 264), pourquoi Bogomolov a mis ces phrases entre guillemets est un mystère. Comme vous pouvez le constater, lecteur, j’avais toutes les raisons de qualifier l’œuvre de Bogomolov de roman policier. Et on ne peut pas considérer comme prouvé que Vlasov n'était pas au PO à Lobnya.
(À proprement parler, il n'était pas nécessaire de décortiquer pièce par pièce les versions de Bogomolov : il suffit de se référer à la description de combat du commandant de l'armée Vlasov, écrite le 24 janvier 1942 (lors du résumé de la bataille de Moscou) : « Il a dirigé les opérations de la 20e armée : une contre-attaque sur la ville de Solnechnogorsk, l'offensive des troupes de l'armée en direction de Volokolamsk et la percée de la ligne défensive sur la rivière Lama. Personnellement, le lieutenant-général Vlasov est bien préparé sur le plan opérationnel, il a de bonnes capacités d'organisation. Le document est clair, concis et ne permet pas de double interprétation. Il a été signé par le commandant du front occidental, le général d'armée G.K. Joukov, et ses subordonnés ont toujours été stricts et n'ont pas toléré les fainéants. l'armée, n'avait pas de favoris et était avare d'éloges. Les mots « se débrouille bien » équivalent à la plus haute certification et il est impossible d'imaginer que Joukov ait nommé Vlasov à l'Ordre du Drapeau rouge si le seul mérite militaire du commandant de l'armée. il s'agissait d'une inflammation de l'oreille moyenne.)
Bien sûr, Bogomolov avait le droit d’utiliser le livre de Sandalov, mais je n’ai tout simplement pas le droit de supposer qu’il n’a pas travaillé dans les archives. Mais j'aimerais voir non pas des extraits de documents dans une narration libre, mais les documents eux-mêmes : ces matériaux peuvent en réalité ne pas coïncider. À en juger par la façon dont Bogomolov cite le roman, une telle peur a des raisons. Par exemple, une citation sur Vlassov est donnée sous la forme suivante : « On pourrait faire confiance à un homme avec un tel visage de manière imprudente... » Voilà, disent-ils, à quel point Vladimov écrit flatteur à propos du traître. Ainsi, dans le roman, il y a une virgule à cet endroit, puis il suit : « et peut-être qu’un observateur, surtout passionné, avec une longue expérience du monde, aurait discerné en lui la tromperie qui échappe aux autres. » C'est là que se situe le problème. Et selon la méthode de Bogomolov, vous pouvez transformer n’importe quelle pensée en son contraire. Autre exemple : « En décembre 1941, Kobrissov ne pouvait pas se voir attribuer deux hectares de terrain à Aprelevra. » La vérité est qu’ils ne le pouvaient pas. Ils ne m’ont même pas donné six cents mètres carrés. Ni Kobrisov, ni personne d’autre. Un fait historique inconditionnel et incontestable, même si tout cela n’a rien à voir avec le roman. L'épouse de Kobrissov dit "qu'ils vont enrôler des généraux dans des chalets d'été". Les épouses, vous savez, s'efforcent souvent d'anticiper les événements, elles ont une telle faiblesse, mais les commérages des femmes ne sont pas un décret du gouvernement, n'est-ce pas ? Ils vont l’enregistrer – alors de quoi discuter ? Dites ce que vous voulez, mais il me semble parfois que Bogomolov a écrit pour des gens qui non seulement n'ont pas lu un seul livre d'histoire, mais qui n'ont même jamais vu de roman.
Bogomolov souhaite également que les personnages du roman s'expriment dans des conversations avec la précision des documents officiels. Le major Svetlookoe demande : « Connaissez-vous Kalmykova du tribunal ? Dactylographe senior." Un tel poste n'existait pas - « dactylo senior » ! - Bogomolov s'indigne, et tous ces cas s'additionnent, "convainquant" Vladimov d'ignorance totale des réalités de la vie militaire. Je dois l’avouer, je ne sais pas non plus s’il existait un tel poste, mais comme il y avait trois dactylographes, une plus âgée et deux juste des filles, alors c’est sûr qu’on l’appelait toujours senior : elle était senior dans les affaires. C’est la même chose dans la vie civile, et encore plus dans l’armée. Mais le roman ne dit rien sur la position - encore une fois, Bogomolov fait passer sa propre impression pour le texte. Bogomolov a dénombré plusieurs dizaines de ces « erreurs ».
Passons maintenant aux détails les plus sérieux. Bogomolov est indigné par l'épisode où, lors de l'assemblée « générale » précédant la prise de Predslavl, Khrouchtchev a distribué des cadeaux : montres personnalisées, cognac, chemises ukrainiennes brodées. Les généraux, écrit Bogomolov, "ne pouvaient pas, comme les indigènes, se réjouir des cadeaux de Khrouchtchev" - en 1943, ils avaient assez de cognac dans leur maison, l'approvisionnement était établi, mais Vladimov, encore une fois, ne connaît pas la vie, ne sait pas comprendre « à quel point tout cela est absurde ». Pourquoi l'approvisionnement de l'armée en cognac est si important, je ne sais pas, et toute l'interprétation est, pour le moins, douteuse : les cadeaux ne venaient pas du tout de Khrouchtchev, mais « au nom de, c'est-à-dire du Conseil militaire ». du front", et si quelqu'un essayait de ne pas être content, lui, cela signifie que le Conseil militaire sera insulté, et même s'il était général trois fois, vous n'aurez plus à envier son sort futur. Et tout comme en tant qu’être humain, ce n’est pas le cadeau qui est précieux, mais l’attention, et ce serait ridicule de refuser une montre personnalisée, car je pense que les généraux avaient des montres. Mais la distribution de chemises ukrainiennes, qui revêtent une signification idéologique particulière : la « perle de l'Ukraine » est en train d'être libérée par les Ukrainiens ! - c'est une véritable absurdité, mais si familière, si soviétique et peut-être moins absurde que le slogan de la libération de Kiev à l'occasion du 26e anniversaire de la révolution. Vladimov sait "à quel point c'est absurde" - c'est ce qu'il écrit.
Et encore - pour la énième fois ! - Je suis obligé de noter les fantasmes de Bogomolov : dans le roman, il n'y a pas un mot selon lequel les généraux se réjouissaient des cadeaux. Ils n'ont pas le temps du tout pour cela, ils sont occupés par les affaires et seulement par les blagues de Khrouchtchev. Mais si l'on y réfléchit, il y a une certaine subtilité dans cet épisode, et on ne peut pas dire catégoriquement que Bogomolov n'avait aucune raison de s'indigner. Il avait des raisons, quoique particulières. Et en effet, il y a quelque chose d'offensant pour les généraux rassemblés dans la procédure même de distribution des cadeaux, dans les plaisanteries de Khrouchtchev et dans le fait de déclarer tout le monde ukrainien : non pas les généraux, comme les indigènes, mais Khrouchtchev avec eux, comme les indigènes ! Cette scène est très proche dans son esprit de ce que nous savons dans d'autres livres : comment Staline a soudé et offert des cadeaux à ses plus proches collaborateurs (y compris Khrouchtchev) lors de rassemblements restreints, tout en humiliant tout le monde. Eh bien, c’est le talent de Vladimov, qui nous a fait ressentir l’esprit de servilité omniprésent implanté par le leader. Mais pourquoi Bogomolov a-t-il été offensé par l'auteur et non par les normes de la vie soviétique ? Dieu seul sait...
Une autre "inexactitude" - le "Smershevets" Svetlookov semble trop omnipotent dans le roman. Bogomolov explique longuement que ce n'est pas le cas. cela était et ne pouvait pas être, il cite même des incidents de la vie, bien qu'il désigne tous les noms avec seulement deux lettres, comme si cette information était secrète. Pourquoi avons-nous besoin d’histoires réelles si nous ne sommes pas nous-mêmes originaires d’Amérique ? Dans un État totalitaire, les services de sécurité ont tout le pouvoir, et le mot « organes » n’a une signification particulière que dans la langue russe, comme il est apparu à l’époque soviétique ; Et dans le propre roman de Vladimir Bogomolov « La minute de vérité », il est écrit : « Les corps de Smersh étaient directement subordonnés au commandant en chef suprême, le commissaire du peuple à la défense I.V. Staline. » D'où la toute-puissance. Mais à quel point c'était génial, le lecteur moderne ne peut même pas imaginer. Et plus loin. Dans le même roman, le capitaine Anikushin veut - bien que ce ne soit pas pertinent - se plaindre des détectives de Smersh ; il envisage d'écrire un rapport, mais pas à ses supérieurs, mais directement à Moscou : « Mais pas au major et pas à le chef de la garnison - ces gens-là, peut-être, ne voudront pas se mêler aux officiers spéciaux, ils ne chercheront pas les ennuis.» Les héros de Bogomolov savaient de quel genre de problème il s’agissait, mais l’auteur lui-même l’a soudainement oublié.
En un mot, Bogomolov a effectué une perquisition, mais n'a pas atteint le « moment de vérité ». Et j'aimerais y mettre un terme, mais le dernier numéro de « LG » est arrivé (06/07/95) avec un article de P. Basinsky « Jouer à la marelle sur le sang de quelqu'un d'autre », où le sous-titre « Drame littéraire » serait approprié. Après avoir lu les articles de Bogomolov dans la Critique du livre, le critique a soudainement vu la lumière et a déclaré que son ancien amour pour le « Général... » était une hérésie et une illusion. "Je suis prêt à admettre ma défaite personnelle en tant que critique, excusée seulement en partie par le fait que j'ai loué le roman de Vladimov comme étant non pas "militaire"", se repent sincèrement Basinsky. Mais cette idée n'est apparemment pas définitive, car la question demeure : « Peut-on considérer comme beau un roman sur la guerre dans lequel l'auteur, comme le prouve pédantement Vladimir Bogomolov... ment simplement - parfois involontairement, parfois volontairement ?
L’éthique de cette dernière question ne mérite pas d’être discutée, car la défaite de Basinsky est incontestable et nullement excusable. Le critique doit lire attentivement, comparer les faits et réfléchir. Comparez au moins le texte du roman avec l’article si vous n’avez pas le temps de consulter d’autres sources. Les « preuves pédantes » de Bogomolov sont si grossières que l’intonation de l’article à elle seule devrait vous alerter sur le fait que cette intonation date d’hier. Personne n’a jamais été capable d’écrire un excellent livre sur le mensonge. Hier, admirer un roman, et aujourd'hui dire que l'auteur « ment » est indécent pour un adulte, même s'il n'est pas critique. Vous devez avoir votre propre position ! S’il n’existe pas, il ne faut même pas prendre la plume. En analysant le matériel de Bogomolov, j'ai évité les évaluations sévères, mais maintenant il n'y a nulle part où échapper, je dirai : la manipulation, les ajouts et la critique de ce qui manque dans le roman sont des mensonges. Évident et délibéré. Et après avoir pris connaissance du « drame littéraire » de Basinsky, je me suis posé une nouvelle question : a-t-il lu le roman de Vladimov ou seulement ce qu'on écrit sur le « Général... » dans les périodiques ?
Un petit épilogue. Étonnamment, ceux qui ont fait l'éloge et ceux qui ont critiqué "Général..." ont beaucoup écrit sur l'historicité du roman, bien qu'à chaque fois ils aient contourné le personnage principal, Kobrissov. Joukov, Vatoutine, Tchernyakhovsky, Vlasov, Guderian - un kaléidoscope de noms de famille, de fragments de documents et de mémoires, une interprétation du rôle, de la signification et même du caractère moral de ces individus avec des conclusions et des généralisations profondes. Et le « commandant silencieux » Kobrisov est resté dans l’ombre. Eh bien, c'est en partie vrai. Cela signifie que Vladimov a pu écrire son général de telle manière que sa suite le joue à la fois dans le roman et dans la vie littéraire ultérieure.
Cela signifie qu’une romance classique a eu lieu et qu’il n’est pas nécessaire de se tordre les mains lorsque Vladimov est surpris en train de faire des « erreurs ». C'est Basinsky qui estime que le roman parle « d'un général classique en dehors du temps et de l'espace », une sorte d'image collective. Peu importe comment c'est ! Le roman parle d'un général russe qui n'est jamais devenu pleinement soviétique. Peut-être que je le voulais, mais ça n’a pas marché. Il y avait de tels généraux. Dans notre temps et, plus encore, dans notre espace.
Mots clés: Georgy Vladimov, «Le général et son armée», critique des œuvres de Georgy Vladimov, critique des œuvres de Georgy Vladimov, analyse des œuvres de Georgy Vladimov, télécharger critique, télécharger analyse, télécharger gratuitement, littérature russe du XXe siècle.
Georgy Nikolaevich Vladimov (1931-2003) a commencé à publier en 1954. En 1961, sa première histoire, «Big Ore», fut publiée dans Novy Mir, qui fut bientôt traduite dans de nombreuses langues des peuples de l'URSS et des pays étrangers. L’œuvre suivante de Vladimov, le roman « Trois minutes de silence », a été vivement critiquée. Il n'était plus publié en Russie. Après son départ pour l'Allemagne en 1983, l'écrivain est privé de la nationalité russe. Alors qu'il vivait en Allemagne, Vladimov a terminé son travail sur le roman « Le général et son armée », publié dans la revue « Znamya » (1994, n° 4-5). La version magazine ne contenait que quatre chapitres. Dans la première édition du livre, le roman comptait déjà sept chapitres. Tout en travaillant sur le roman, Vladimov s'est tourné vers le réalisme. Il a écrit : « … ce réalisme haineux a été mis dans un cercueil, un service funèbre a été célébré et enterré, une veillée funéraire a été célébrée pour lui. Mais dès qu'il a déménagé, l'intérêt accru des lecteurs a été attiré par le roman, qui est assez conservateur, dans lequel il n'y a pas de fioritures avant-gardistes et de gribouillages postmodernes habituels. Il semble que le lecteur soit fatigué de ces astuces et zagogs, ou plutôt, fatigué de prétendre qu'ils l'intéressent, il voulait quelque chose d'intelligible, où il y aurait un début et une fin, un début et un dénouement, une exposition et un point culminant, tout cela selon les recettes du vieil Homère. L'écrivain s'est tourné vers les événements de la Seconde Guerre mondiale. Les événements du roman s'étendent de Khalgin-Gol à Brest, de 1917 à 1958. Le roman dépeint trois généraux et leurs relations avec l'armée. C'est F.I. Kobrissov, G.V. Guderian et A.A. Vlassov. Le premier d’entre eux, qui est le personnage principal du livre, contraste avec d’autres personnages. L'intrigue du roman se développe en cercles concentriques. L'un des thèmes principaux de l'œuvre est le thème de la trahison. Le roman est imprégné de pathétique anti-guerre ; l'écrivain véhicule l'idée que la grandeur d'un commandant se mesure au nombre de soldats sauvés. Vladimov, selon les critiques, a créé son propre mythe artistique sur la guerre de 1941-1945. Il repense le rôle des véritables chefs militaires dans les événements de la Grande Guerre patriotique (il ne s'agit pas seulement de Guderian, Vlasov, mais aussi de Joukov, Khrouchtchev, Vatoutine et d'autres). Kobrisov, Vatoutine, Vlasov, passés aux côtés des nazis, Guderian estiment que l'essentiel de la stratégie militaire est la science de la retraite, préservant ainsi la vie de milliers de soldats. Ils sont opposés dans le roman par Joukov et Terechchenko, prônant la victoire à tout prix. L'intrigue du roman est basée sur le voyage du général Kobrisov du front à Moscou, puis son retour dans son armée. L'épisode central de l'œuvre est une réunion au cours de laquelle, sous la direction de Joukov, les généraux décident du sort de la ville de Myryatin. La ville est aux mains des nazis, mais elle est défendue par d'anciens soldats soviétiques. Matériel du site Le roman présente de véritables personnages historiques : le maréchal Joukov, le général d'armée Vatoutine, membre du Conseil militaire du premier front ukrainien Khrouchtchev, commandant de la 2e armée de choc, le colonel général Vlasov, le célèbre chef militaire allemand Heinz Guderian. À propos de l'image de ce dernier, V. Lukyanov a noté à juste titre : « Vladimov, pour la première fois dans la littérature russe, a détruit la barrière, a mesuré pour la première fois un général de l'armée ennemie (c'est-à-dire Guderian) avec un critère humain universel - et a raconté une histoire perçante sur la tragédie de l’honneur chevaleresque qui s’est retrouvé au service du déshonneur… ».
Dès les premières pages du roman, l'auteur s'inscrit dans la tradition épique de « Guerre et Paix » de L.N. Tolstoï. Cela se manifeste avant tout dans la résolution du problème de la liberté et de l’indépendance. Deuxièmement, bien que le livre de Vladimov parle de guerre, le conflit militaire est de nature morale et psychologique.
Vladimov reste fidèle au réalisme dans la représentation des événements, des personnages et dans la compréhension de ce qui se passe.
Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ? Utilisez la recherche
Sur cette page, vous trouverez du matériel sur les sujets suivants :
- Créativité de Georgy Vladimov
- Le général Vladimov et son résumé de l'armée
- Georgy Vladimov, biographie, présentation de la créativité